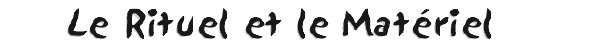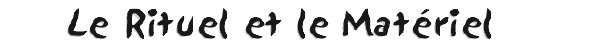|
IV - 12.3 Le rire comparé aux états émotionnels causés par la surprise
“Le contraire du rire n’est pas le sérieux, c’est la réalité.”
(G.W.H. Hegel)
 Le rire résulte d’une perception globale, non analytique, de la situation gélogène : on rit avant de pouvoir dire pourquoi l’on rit (cette perception implique le “cerveau droit” : vide infra, chapitre 18). Le rire résulte d’une perception globale, non analytique, de la situation gélogène : on rit avant de pouvoir dire pourquoi l’on rit (cette perception implique le “cerveau droit” : vide infra, chapitre 18).
 Le rire constitue une réponse réflexe à la rupture. Il engage des circuits neurologiques capables de travailler indépendamment du cerveau volontaire. Les réflexes, par comparaison avec les réponses calculées, ont un double avantage de rapidité et d’autonomie. Le rire constitue une réponse réflexe à la rupture. Il engage des circuits neurologiques capables de travailler indépendamment du cerveau volontaire. Les réflexes, par comparaison avec les réponses calculées, ont un double avantage de rapidité et d’autonomie.
 Le rire est une réponse émotionnelle à la surprise. Cette réponse procède d’une mise en communication de l’aire de la personnalité, située dans le cortex frontal et du “cerveau des émotions” (hypothalamus). Le rire est une réponse émotionnelle à la surprise. Cette réponse procède d’une mise en communication de l’aire de la personnalité, située dans le cortex frontal et du “cerveau des émotions” (hypothalamus).
Ces trois données militent pour une approche élémentaire du rire.
Au titre de l’élémentaire et de l’organique, on peut commencer par rappeler que le rire est la plus violente et la plus banale des secousses émotionnelles.
“Chacun void bien, développe Joubert (op. cit. p. 42) que pour le Ris, soudain le visage est ému, la bouche s'élargit, les yeux étincellent et pleurent, les joues rougissent, la poitrine est secousse, la vois antrerompue ; et quand il se déborde continué long-tams, les veines du cou s'anflent, les bras tramblent, et les jambes trepignent, le ventre se retire et sant grand douleur ; on roussit, on sue, on pisse, on fiante à force de rire et quelquefois on en avanouit.”
Énorme, irrépressible, a fortiori quand il est contenu, comme l'exprime – en mauvaise part – Bernard de Clairvaux :
“Ce moine qui a rempli son cœur de pensées vaines et bouffonnes et dont le vent de la vanité ne peut, en raison de la discipline du silence, se répandre pleinement, est secoué d’éclats de rire jaillissant par les détroits de sa gorge. De honte, il cache souvent son visage, serre les dents, mais malgré lui, il rit, et contraint, pouffe de rire. Et quand de ses poings il obstrue sa bouche, on l’entend éternuer par les narines.” (“Tractatus de gradibus humilitatis et superbiae”, Patrologie latine, t. 182, col. 964)
ou Cervantès :
“Don Quichotte se mit aussitôt à regarder Sancho et vit qu'il avait les joues enflées et en apparence tout prêt d’éclater de rire ; et comme Sancho vit que son maître avait commencé, il lâcha la bonde de telle façon qu'il fut contraint de se serrer les flancs avec ses deux poings pour ne pas crever. Il se calma par quatre fois et autant de fois recommença sa risée, avec la même impétuosité que la première [...]” (Don Quichotte)
L’expression des émotions est sous le contrôle du système nerveux autonome qui assure aussi la régulation automatique de nombreuses fonctions organiques. Ses opérations mettent en jeu deux sous-systèmes antagonistes : le sympathique et le parasympathique, l’“accélérateur” et le “frein”. (Le système nerveux autonome est donc, par essence, sujet à l’instabilité et au déséquilibre). Le premier commande le régime de l’action. Il a notamment pour objet de mobiliser l’organisme en situation de danger : il augmente la production d’adrénaline, accélère le rythme cardiaque, freine le péristaltisme digestif et réduit les sécrétions peptiques. Il fait dresser les cheveux sur la tête. (Le sympathicotonique a les pupilles dilatées et la bouche sèche, c’est un surexcité ; il fait de l’hypertension ou souffre d’ulcères à l’estomac...). Le second a une fonction opposée de sédation et de détente.
Considérons l’exemple classique des réactions en chaîne dont l’organisme est le siège devant une menace physique soudaine. À partir d’un signal vigile, l’alerte (un influx nerveux électrique) est transmise dans le centre des émotions. L’hypothalamus envoie un message chimique à l’hypophyse qui augmente alors sa production corticotrope. Véhiculée par le sang, l’hormone en cause stimule la sécrétion surrénale. L’adaptation est immédiate et spectaculaire. Le système agression-défense est mis “sous pression”. Les organes impliqués sont irrigués en priorité. La respiration devient plus forte et plus profonde. Le cœur se met à battre plus vite et plus puissamment. Les muscles se durcissent. Les vaisseaux qui irriguent l’appareil digestif et la peau se contractent : le sujet pâlit et la digestion est suspendue. En cas de blessure, l’hémorragie est modérée, l’inflammation limitée, la coagulation plus rapide et la douleur moindre. Un homme raconte que, se relevant après une violente chute de moto et retirant son blouson de protection, il constate qu’il a le bras arraché - sans éprouver de douleur locale en proportion avec un tel trauma. Le foie libère ses réserves de sucre pour alimenter les muscles. La transpiration augmente pour une ventilation d’appoint indispensable pour assurer l’homéothermie générale pendant cette combustion accrue d’énergie...
Nous n’avons pas choisi cet exemple au hasard, car les circonstances qui provoquent le rire causent aussi une surprise - qui se résout, non par l’agression ou la fuite, mais par une violence plaisante qui secoue le corps de... l’interloqué. Comme la réponse au message “danger”, le rire est réflexe et organique. Il est des situations tendues, des conflits qui soudain se détendent et se résorbent dans un rire d’autant plus salutaire, sinon d’autant plus franc, qu’on a “frôlé le drame”. Cette alternative correspond à deux solutions d’un même problème et, peut-être, à deux réponses à une même information neuropsychologique. Mais le rire est une émotion (subjective) avant d’être une action (objective). Bien qu’une analyse psychologique et sociologique du rire puisse mettre en évidence une fonction agressive du rire - nous y reviendrons - c’est cet aspect d’humeur, ou cet aspect endocrine, qu’il faut d’abord considérer. Le rire apparaît alors comme la résolution soudaine d’une crise qui se révèle sans danger (souvenons-nous de la définition d’Aristote). Il fait suite à une alerte qui n’est pas une fausse alerte, mais à laquelle il est fait face et mis fin, non par des moyens externes et objectifs, mais par des moyens internes et subjectifs : par les moyens d’une “rassurance” et d’une réassurance endocrine.
C’est une banalité de constater que le rire développe des effets contraires à ceux de la peur. Regardons pourtant. Dans une bibliothèque, un “type” (vide supra) se lève de sa chaise, s’empêtre dans celle de son voisin et manque de se “casser la figure”. On lit un temps d’étonnement stupide (ind.-eur. : *(s)teu : frapper) sur son visage, puis, presque aussitôt, il s’esclaffe : détente. Il a “eu chaud”, il l’a “échappé belle”... Si l’on observait au ralenti le film des mimiques de l’éclat de rire, il est probable que les premières images montreraient le visage d’un homme effrayé, à tout le moins stupéfait ou incrédule, retrouvant, peut-être, la façon dont les anciens Grecs exprimaient le “non” : ananeuô (Lysistrata : 126 ; les faux ambassadeurs perses des Acharniens : 113 s. se trahissent à leur manière grecque de marquer le “non”, manière qui peut encore être observée aujourd’hui - Eibl-Eibesfeldt, 1976 : 35 – pour la traduction française de Der Vorprogrammierte Mensch) haussant le sourcil, rejetant la tête en arrière et relevant le menton, vérifiant cette exclamation qu’on peut entendre parfois au vu d’une apparition bouffonne : “Non ! c’est pas vrai !” Cette mobilisation soudaine pour rétablir l’équilibre s’est immédiatement révélée efficace : rire.
Comme l’alerte organique dont nous venons de rappeler le scénario et le dessein, le rire, cette violence qui secoue l’agressé ou l’interloqué et qui le dispense de secouer l’agresseur ou l’interlocuteur, se signale par une consommation accrue de substances neurorégulatrices, dites hormones de l’éveil, et cette décharge bruyante et brutale peut apparaître comme une destruction de munitions inutiles : le tir à blanc d’une fantasia de soulagement ou d’une victoire sans combat. Alors que le stress d’alerte s’exprime notamment par une augmentation du volume respiratoire qui multiplie la combustion énergétique, c’est ici l’expiration qui commande le processus respiratoire : une expulsion violente et saccadée de l’air inspiré, accompagnée de ces vocalisations, “Ah, ah, ah !” qui résument le rire. Le rire est dit faire circuler dans le corps cette bonne humeur qui chasse les déchets de la combustion vitale et rétablit l’équilibre en résorbant les toxines du stress. Alors que l’alarme accélère le rythme cardiaque et provoque une contraction vasculaire et musculaire, le rire, ce spasme respiratoire, relâche les muscles (notamment les masséters - et parfois les sphincters), dilate les vaisseaux et apaise le cœur.
Mais cette description homéostatique (résorption d’une crise panique par une crise de rire) néglige un point d’importance. Le rire ne répondrait pas seulement au soulagement de l’esquive, à l’issue (finalement) heureuse d’un mauvais pas, à l’élimination réflexe, le danger évanoui, de substances roboratives. Le rire décharge, sans doute, mais il n’est pas inutile de noter comment cette mécanique procède encore de l’impulsion du danger. Car une propriété remarquable de ces hormones de l’éveil synthétisées par le cerveau mis en alerte est de libérer la production d’endorphines, morphines naturelles qui agissent contre la douleur. Cette décharge d’opium cérébral n’est pas sans effet pour le sujet qui nous occupe. Car il existe une propriété bien connue de l’anesthésie qui permet de mettre en relation physiologie et psychologie du rire.
Le mot “hilarant” apparaît pour la première fois dans le dictionnaire en 1805 pour caractériser un composé chimique, le protoxyde d’azote. On trouve dans Littré (s. v. Hilarant) la citation suivante extraite de l’Abrégé de Chimie de Pelouze et Frémy : “Le protoxyde d’azote est impropre à la respiration ; introduit dans les organes respiratoires, il produit une sorte d’ivresse qui lui a fait donner le nom de gaz hilariant”. Le gaz hilarant allait devenir une attraction foraine. Moins plaisant, mais d’une autre portée, le protoxyde d’azote devait révéler des propriétés analgésiques qui permirent l’essor de la chirurgie moderne : l’anesthésie générale a recours à ce gaz singulier. Le MEOPA (acronyme de : “mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d'azote”, soit N2 O2) est aujourd'hui utilisé en pédiatrie.
Quel rapport entre “endormir la douleur” et “rire” ? L’hypothèse ici développée consiste précisément à poser que cette proximité fonctionnelle de l’anesthésie et du rire, “chimiquement prouvée” par les effets du protoxyde d’azote, peut constituer une voie d’accès à la compréhension du rire. En effet, que la cause soit purement matérielle (gaz hilarant, alcool... ; empoisonnement cérébral : rire sarde, par exemple ; atrophie cérébrale ou dégénérescence de la chimie neuro-médiatrice : épilepsie gélastique, maladie de Pick… où le sujet est incapable de rien prendre au sérieux ; chatouillement : excitation d’une zone réflexe qui opère un court-circuit de la sensibilité) ou purement intellectuelle (rupture brusque de la continuité noétique), le rire s’analyserait comme une suspension de la communication entre le “cerveau du réel” et le “cerveau émotionnel”.
Prospectus pour une démonstration de gaz hilarant,
1844, Nouvelle-Angleterre, vint-cinq cents l’inhalation.
“Une grande démonstration des effets produits par l’inhalation de Protoxyde d’Azote, ou Gaz Hilarant ! sera donnée à l’Union Hall ce (Mardi) Soir, 10 décembre 1844.
Quarante gallons de gaz seront préparés et administrés à ceux qui, dans l’auditoire, désireront en inhaler.
Pour commencer le spectacle, le Gaz sera inhalé par douze jeunes gens qui se sont portés volontaires.
Huit costauds ont été engagés et se tiendront au premier rang afin d’éviter que, sous l’influence du gaz, personne ne se blesse ou blesse quelqu’un d’autre. L’adoption de cette mesure vise uniquement à écarter toute appréhension de danger. Il est probable que personne ne cherchera à se battre.
Le Gaz agit sur ceux qui l’inhalent en fonction du trait dominant de leur caractère. Il les fait soir Rire, Danser, Parler ou se Battre, et ainsi de suite. Ils semblent conserver assez de lucidité pour ne pas dire ou faire des choses qu’ils auraient l’occasion de regretter.
N.B. Le Gaz ne sera administré qu’à des hommes d’une parfaite honorabilité. Ceci afin que le spectacle reste, à tous égards, dans les limites du bon ton. ”
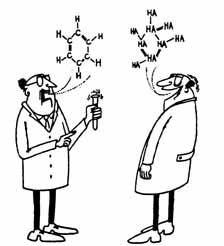
Ce dessin sans légende de Cork (relevé dans Zeitgenossen karikieren Zeitgenossen, Rhurfestspiele Recklinghausen, 1972 : 208), pourrait servir d’illustration à la “chimie du rire”.
Toutefois, à la différence de la molécule de benzène retenue par le dessinateur, qui autorise, par symétrie, une symbolisation spatiale du rire - qui permet de faire éclater le rire - la représentation à laquelle l’exactitude obligerait (N2 0 au lieu de C6 H6 ) est moins photogénique.
La carrière parallèle d’une attraction foraine
La première opération sous anesthésie est réalisée sur l’animal, en 1824, par inhalation de gaz carbonique. Le protoxyde d’azote (N2 O), obtenu par la combustion du nitrate d’ammonium, est isolé en 1772 par le philosophe Joseph Priestley, pasteur, théologien et chimiste qui, en butte aux persécutions des autorités pour son socinianisme et du populaire pour les émanations diaboliques que ses cornues répandaient autour de sa maison, s’exile en Nouvelle-Angleterre. Les propriétés anesthésiques et inébriantes de ce gaz sont relevées en 1799 par Davy ; la première application clinique est faite par le dentiste américain Wells, en 1846 (cobaye de ses propres expérimentations, Wells sombrera dans la folie).
Le protoxyde d’azote a plus récemment fait parler de lui dans une affaire criminelle : la mort “sur table”, après anesthésie, à l’hôpital de Poitiers, le 10 octobre 1984, de Mme Nicole B. Comment une patiente jeune, ne présentant aucun antécédent cardiaque, aucune contre-indication à l’anesthésie n’a-t-elle pu être réanimée après une narcose dont la première phase s’était déroulée normalement ? Comment, au contraire, pouvait-elle présenter soudain des signes de cyanose alors qu’on lui administrait (croyait-on) de l’oxygène à des doses de plus en plus élevées et que ses poumons étaient régulièrement ventilés ? C’est (vraisemblablement) qu’une main criminelle avait inversé les flexibles amenant respectivement au respirateur l’oxygène et le protoxyde d’azote, repérables par des bagues de couleurs différentes et que l’anesthésiste-réanimateur asphyxiait sa patiente en lui administrant du protoxyde d’azote à haute dose tout en croyant l’oxygéner.

Le Monde du 16 février 1988
L’ébriété de l’anesthésie, déconnexion du cerveau sensoriel et du cerveau émotionnel, signalerait donc, non seulement une cause matérielle, exogène, du rire, mais en révèlerait aussi la fonction. (En sorte, d’ailleurs, qu’il ne serait pas nécessaire de postuler l’existence d’une hormone spécifique du rire, comme a pu le faire un professeur de médecine de l’université François Rabelais de Tours - qu’il a proposé d’appeler “rabelaisine” - si celui-ci est une conséquence banale d’une disjonction adaptative circonstancielle qui a pour objet premier de préparer le corps à braver la douleur). Dans cette optique positive, on pourrait comprendre le rire, “énergie contenue qui se libère soudainement”, selon la définition de Raymond Devos, détente de la tension vitale, (et symbolisant banalement l’activité de “détente”), non seulement comme une correction homéostatique résultant de la résorption naturelle des analgésiques cérébraux produits en situation de danger, comme la détente d’une peur sans cause (sérieuse), l’euphorie d’une analgésie sans douleur, mais, à partir de ses effets, dans sa fonction objective d’adaptation au réel. Le spasme expulsif, l’explosion qui caractérise le rire - Novalis notait l’analogie du rire et de l’étincelle électrique - brûle les poisons du stress et rétablit l’équilibre neuro-végétatif par une correction du parasympathique - sédatif, temporisateur, parégorique, anesthésique - au détriment du sympathique qui commande l’action.
Et c’est bien dans sa fonction, paradoxale mais nécessaire, d’adaptation au réel, dans son rôle dans l’apprentissage, que se révèle cette signification originelle du rire, comme le suggèrent et l’ontogenèse et la phylogenèse. Le rire-jeu que l’adulte engage avec le tout-petit est évidemment fonction de sa capacité de réponse, de la maturation de son équipement neurosensoriel et expressif. D'abord révélant à l'enfant son entité corporelle (balancements et chatouilles : “la petite bête qui monte…”), cette interaction se complexifie à partir du sixième mois dans des jeux sociaux où les limites somatiques et les rôles sont expérimentés, notamment dans le jeu - emblématique de l’attente et de la surprise espérée - de la disparition et de la réapparition de la face (“coucou !”). L’observation systématique des conditions d'apparition du rire chez le petit enfant (Sroufe et Wunsch, 1972 ; Sroufe et Waters, 1976), à partir de la douzième semaine, révèle que le rire sanctionne la maîtrise de situations insolites, l’exploration réussie de la nouveauté et la réassurance cognitive - dans des conditions de sécurité et de familiarité, avec des proches ou des figures connues, et dans un climat de détente et de jeu. À l'inverse, en effet, telle situation qui, dans ce contexte de sécurité, se dénoue par le rire, va provoquer les pleurs du petit si elle dure trop longtemps ou si la surprise est trop forte. Le rire est la récompense d'une peur maîtrisée.
Associé au jeu, le rire l’est phylogénétiquement à la découverte et à l’apprentissage. C’est précisément dans cet environnement que l’éthologie a pu établir, chez le primate, l’origine vraisemblable du rire (Van Hoof, 1972 et 1978). Le jeu apparaît d’évidence dans le règne animal comme étant le privilège du jeune. Dans les relations engageant la mère et son petit, ou des jeunes entre eux, les primates utilisent régulièrement des mimiques, que nous qualifierions anthropomorphiquement de “rictus”, qui paraissent être une ritualisation (au sens de Huxley) signifiant au congénère l’intention ludique de l’interaction proposée. Si l’euphorie du jeu, comme l’euphorie du rire, vaut insensibilité au réel, comme il a été noté, les signes de cette insensibilité - découvrir les dents : vide infra - peuvent annoncer cette intention. Un tel échange de signes accompagnant la “provocation pour rire” s’observe couramment chez l’homme. À l’occasion d’un arrêt, le jeune chauffeur d’un taxi-brousse subtilise à son coéquipier une mangue dans laquelle celui-ci s’apprêtait à mordre… Il lui signifie aussitôt en découvrant les dents et en riant bruyamment le caractère ludique de ce vol à l'arraché. L’autre ne peut que rire à son tour sous peine de se mettre hors-jeu, de se voir accuser de tout prendre au sérieux, de n’être pas drôle, etc. Le cerveau analytique des mammifères se caractérise aussi par des programmes d’apprentissage ouverts et une plus ou moins longue néoténie. C’est par imitation et par jeu que le jeune assimile les techniques d’alimentation, de chasse, de défense… et qu’il fait, sans risque (au seul risque de se faire corriger, c’est le mot, par les adultes qui surveillent les jeux infantiles et par la dure loi de la réalité), l’épreuve de la vie. Les jeux locomoteurs provoquent des modifications dans l'organisation synaptique du cerebellum et dans la distribution des fibres musculaires (Byers et Walker, 1995). Des chimpanzés privés de jeux (et notamment de jeux d'objets, soit de manipulations non fonctionnelles) s'avèrent moins compétents dans l'utilisation d'outils (Byrne, 1995). Le jeu est cet état d'esprit où s’apprend le réel, l’essai gratuit de situations “à vide”, “pour rire”, un entraînement. C’est “juste pour rire”, c'est pas “pour de vrai”. Le spectacle de la réponse inadéquate, qui nous fait rire, nous replonge immédiatement dans cette enfance de l’art, quand on ne sait (presque) rien, dans ce vert paradis des enfantillages, bain d’innocence formatrice qui prépare à affronter le réel. Avec ce surplus de vitalité, tel le cabri qui cabriole et décolle du sol des quatre pattes à la fois ou le chiot qui guenille à mort la savate de son maître, le petit est infatigable et incorrigible : il faut souvent le rabrouer d’un bon coup de dents ou d’une chiquenaude pour qu'il vous fiche la paix et qu’il apprenne - il couine un peu, et remet ça cinq minutes plus tard. Un proverbe japonais dit qu’il est tout aussi impossible d’empêcher les enfants de grimper que la fumée de monter. Le naturel du jeu enfantin, associé à l’insouciance et à la joie de vivre, nous stupéfie donc d’autant plus quand nous regardons jouer les enfants des rues dans les villes du Tiers Monde, qui nous paraissent avoir… toutes raisons de souciance. Il y a dans l’état d'esprit du jeu et dans l’état d'esprit du rire une fraternité originelle. C’est vraisemblablement parce qu’il est programmé pour apprendre, c’est-à-dire pour se tromper, que le petit doit être “blindé”, protégé de l'erreur, insensible. L’insouciance et l’irresponsabilité, l’“inconscience” et l’“ivresse”, l’insensibilité, propriétés du jeu et de la curiosité infantile, sont nécessaires pour surmonter l’appréhension de l’inconnu - pour découvrir. C’est en jouant qu'on apprend à gérer des situations dont on peut ensuite se jouer. Il faut répéter, engrammer la bonne réponse. Mais pour ce faire, il faut y aller bille en tête. Pour apprendre, mieux vaut donc être hors de la réalité - qui oblige, qui impose la vigilance et le sérieux -, habiter la bulle de l’enfance. Le plaisir du rire, l’“euphorie”, note Freud dans le Mot d’esprit, exprime “l’humeur de notre enfance”. Le jeu et le rire, incitation et prime à l’apprentissage, permettent ainsi d’observer le passage de la position passive à la position active : ce qui a provoqué l’amusement du petit est à son tour activé par le petit. Il existe d’ailleurs un comique spécifiquement destiné aux enfants, celui du clown. Le clown est un adulte qui fait tout à l’envers et en dépit du bon sens et qui fait rire des enfants qui savent le bon sens. Dans le dialogue qui, généralement, s’engage entre l’artiste et son public, les enfants enseignent cet adulte grotesque et sympathique qui fait l’enfant des enfants.
La primatologie (Plooij, 1979 ; Fossey, 1983) invite également à considérer l’interaction de la mère et de son petit dans cette activité qui a aussi le rire pour effet (et pour objet), les chatouilles. La “guili-guililogie” est une discipline fort sérieuse, doctrinalement ouverte par le Stagyrite (Parties de animaux, 673 b 7-10 ; Problèmes, section XXXV) (pour l’époque moderne, voir : Joubert, 1579, en continuité avec les discussions aristotéliciennes sur la fonction du diaphragme dans le rire ; Darwin, 1872 (1877) ; Hecker, 1873 ; Weiskrantz, 1971 ; Blakemore, 1998) quand il est fait état de cette observation selon laquelle une chatouille attendue est moins efficace qu’une chatouille qui arrive par surprise et qu’on ne peut se chatouiller soi-même. Le cerveau (le cervelet) annule, en effet, les sensations proprioceptives (produites par le propre corps du sujet : “personne est étranger à soy”, explique Joubert - op. cit. p. 204) et l’irruption de la chatouille attendue est tempérée par cette représentation. Pour (se) chatouiller il faut donc au moins être deux. Les chatouilles peuvent être réciproques, “agonistiques”, mais il existe souvent une dissymétrie dans cette interaction qui indique vraisemblablement sa portée “pédagogique”. L’ivresse du jeu (les parents préviennent : Ça va mal finir !.. Ça va tourner en eau de boudin ! Il va bientôt y avoir des larmes !...) à laquelle se livrent les enfants l’est particulièrement des chatouilles auxquelles, provoqués par des adultes familiers (qui, d'ailleurs, se font aussi rabrouer : “jeux de mains, jeux de vilains”... une loi fédérale, en Virginie, interdit de chatouiller les petites filles), les provoquant aussi, ils s’abandonnent jusqu’à la suffocation, s'enfuyant devant l'adulte taquin tout en se laissant attraper par lui, dérobant ces zones offertes à la stimulation, appelant cette sensation insoutenable, recherchée et repoussée... Le plaisir spécifique des chatouilles signale à la fois la contenance et la perte de contenance et permet de distinguer le soi du non-soi, de faire l’expérience d'une impossible fusion (je t’aime, moi non plus) dans l’épreuve des échanges corporels. Alors que la sensibilité tactile de la surface peau est sous contrôle et peut être gérée avec sagesse : “Trop gratter cuit, trop flatter nuit”, le contact des zones gélogènes paraît engager, sinon des réactions réflexes au sens strict, du moins une sensibilité spécifique des parties les plus vulnérables du corps – les zones gélogènes ne sont pas normalement accessibles. Le chatouillé paraît à vif, tel un écorché, et le chatouillement, comme le montrent certaines pratiques sado-masochistes, peut être un supplice. Cette hyperesthésie, défaut dans la cuirasse de notre contenance, est une voie d'accès à l'intimité – quand le simple contact corporel, l’hétéroception, de même que la pénétration d’un étranger dans votre proxémie, suscitent esquive et retrait. C’est lorsque le corps est sans défense, en supination, que ces zones réservées sont ouvertes ou offertes. Éducatrices ou sensuelles, les chatouilles du parent ou du partenaire, ces “petites bêtes qui montent, qui montent...”, “car la main du chatouilleur est suspendue, ores touchant, ores se retirant” (Joubert, op. cit. p. 198) , qui s’immiscent soudainement dans l'intimité (dans les “parties caves” du corps) avec les bras multipliés et les doigts fourmillants de la divinité indienne, mise en scène de l’abandon provoquant à la fois un relâchement convulsif du maintien et une reprise de la contenance, constituent une sténotypie ludique de l’expérience des limites, à la fois du corps et du supportable. “Vray est que cette volupté déplait [“ce sentiment du plaisir déplaisant”] parce que les parties fort délicates, refusent l’attouchement étranger, tant soit-il léger et mignard.” (ibid. p. 201-202) Sur le mode de la fermeture plaisante de la vérité (le haussement de sourcils du “non” des grecs ; peut-être la racine – I.-E. *smey-, grec meidos, lat. mirus – qui a donné le mot grec pour “être ébahi” , “bouche bée” puis “(sou)rire” ), le chatouillé profère un “oui” qui dit “non”, quand le rieur émet un “non” qui dit “si” .
L'exploration par le rire, ostensible et bruyante, extériorisation de la joie dans un environnement sécurisé, permettrait donc à l'enfant de faire l’épreuve de son corps, d’apprendre et de faire société, de mettre sur le monde des balises de vérité, d’expérimenter la causalité matérielle et sociale. Si le rire, empreint de cette excitation intellectuelle et psychique, de cette intensité qui caractérise le jeu est un moyen d’apprendre, l’indice de la découverte de la vérité, la récompense et la douce intempérance de la dure école de la vie, alors le spectacle de l’erreur replonge immédiatement celui qui sait - “Non ! ça n’est pas vrai !”- dans ce bain d’ivresse où se découvre la vérité. Le rire d’homo sapiens est l’expression du plaisir du vrai. Moyen (positif) d’accès à la vérité, il devient le moyen (négatif) de son authentification. Plaisir du vrai et plaisir du faux. Le plaisir du rire est le shoot qui récompense la reconnaissance de l’erreur.
Si nous n’avions pas besoin d’apprendre, nous n’aurions pas nécessité de rire. La maîtrise du réel, l’adresse, de même que la vérité, ne font pas rire. Elles provoquent l’acquiescement tacite ou l’admiration. Alexandre : – Papa, raconte-moi une histoire drôle. Papa : – D'accord. C'est une devinette. Est-ce que tu sais pourquoi il y a un trou au fond des pots de fleur ? Alexandre – Euh ! Bof !... Pour que l'eau puisse s'écouler ? – Mais non, Alexandre, c'est vrai donc ça n'est pas drôle... La vérité ne fait pas rire. Le succès du bouffon tient évidemment au plaisir que nous prenons à nous repaître de l’erreur. Le spectacle, le cirque en particulier, est justement ce cercle où l’on se refait une santé anthropologique, et notamment aux dépens de la déformation et de la difformité. Le rire sanctionne la dégradation, l’“incongruité descendante” de Spencer. Jamais, en effet, l’élévation. Si le clown du cirque Franconi (selon l’exemple de Spencer), qui se prépare à exécuter le saut que vient de réaliser l’acrobate au-dessus des chevaux, répétait à son tour l’exploit auquel les spectateurs viennent d’assister (au lieu de s’arrêter tout à coup au premier cheval après avoir pris un élan formidable, se contentant de brosser la poussière de la croupe là où il était supposé prendre ses appuis) alors ce ne sont pas les “ah ! ah !” brefs et sacccadés du rire qui jailliraient du public, mais bien un long “Aah !” d’admiration, celui qui sanctionne le dépassement de l’humaine condition.
Mais cette maîtrise est aussi culturelle. Les blagues ethniques démontrent à l’envi (notamment) que nous (le cercle des rieurs) sommes dans le vrai et que l’expertise de la réalité que fait l’autre est fausse, tellement fausse qu’elle fait rire. De more satis risi. C’est ma coutume, c’est ma théorie du réel qui est la bonne. L’autre homme est stupide : inadapté. Il ignore les “fondamentaux ”, ceux, justement, que l’apprentissage, la culture, permet de faire siens.
 Florilège Florilège 
L'autre ignore :
- La classification des êtres (et confond, par exemple, le mécanique avec le vivant) :
Comment reconnaît-on un […] dans un aéroport ? Réponse : Il donne des graines aux avions...
- la nature même du vivant :
Au cours de son procès, on reproche à Bokassa le bilan particulièrement meurtrier de ses camps d'internement. Il argumente pour sa défense : Quand on vient me prévenir d'un décès, il est parfois trop tard...
- idem (extrait d'un recueil antique de 265 blagues et facéties intitulé Philoghelos, attribué à Hiéroklès et Philagrios) :
Lors des funérailles d'un illustre citoyen de Cumes, un quidam, étranger à la ville, demande à ceux qui suivent le cortège : “Qui est le mort ?" Un habitant se retourne et répond en montrant le corbillard :“C'est celui qui est couché dans le cercueil."
- les divisions élémentaires du règne animal :
Un joueur [de foot], philosophe Thierry Roland, commentateur vedette de TF1, peut être fauché comme un lapin en plein vol.
- La nature des éléments :
Pourquoi les […] ne font-ils pas de ski nautique ? Réponse : Parce que chez eux, il n’y a pas de lac en pente…
- La signification de l’espace :
Un pilote […] atterrit sur une piste dont on lui a dit qu’elle était extrêmement dangereuse en raison de sa très faible longeur. Il réussit à se poser en mordant généreusement l’herbe et, l’avion immobilisé : “Ils ont bien eu raison de me prévenir de la faible longeur de cette maudite piste, mais alors ! qu’est-ce qu’elle est large !”
- Les marques élémentaires de la civilisation :
Comment reconnaît-on un […] dans un magasin à chaussures ? Réponse : Il essaie les boîtes…
- À l’inverse, il applique les conventions humaines au règne animal :
C’est un […] qui, au temps de César, est jeté aux lions. Quand il constate qu’il est seul dans l’arène avec le fauve et qu’il n’y a pas d’issue, il se met à courir autour de l'arène. L’animal l’observe quelque temps, puis se met à courir après lui. Les spectateurs encouragent le […] et, comme le lion se rapproche dangereusement, l’avertissent : Attention ! il va te rattraper ! Le […] se retourne alors et crie aux spectateurs : Ne vous inquiétez pas ! J’ai un tour d’avance !”
- L'autre ignore, bien entendu, la polysémie :
Pourquoi les […] se mettent-ils en pyjama pour faire de la moto ? Réponse : C’est pour mieux se coucher dans les virages…
et incarne le dépit du bon sens :
Combien faut-il de […] pour changer une ampoule ? Réponse : Cinq : un qui tient l’ampoule et quatre pour tourner la table.
Un hélicoptère s’écrase sur un cimetière. La police […] a déjà identifié 300 victimes…
- L’autre, en somme, est la sottise personnifiée, plus lourdingue que la matière même :
Quand un […] s’appuie sur un mur, le mur s’écroule. Pourquoi ? – Parce que c’est toujours le plus intelligent qui cède…
- Bien évidemment, les chances de transmettre ses gènes (comme dit la vulgate) de cet autre inadapté sont quasi nulles, ainsi que le signifie ce type d'histoire :
C'est un [...] qui est sur la plage avec un [...]. Il s'étonne des succès amoureux de son voisin et lui demande comment il s'y prend pour “lever” autant de filles. L'homme à femmes répond : "C'est facile ! Je vais te dire le truc que j'utilise : Tu prends une belle pomme de terre et tu la mets dans ton maillot de bain. Tu te promènes sur la plage avec ça. Tu vas voir. C'est radical !” Une semaine plus tard, les deux protagonistes se retrouvent sur la plage. “Alors ? imparable mon truc, non ?” – “Je ne comprends vraiment pas, répond l'autre, j'ai fait comme tu m'avais dit et je n'arrive toujours à rien !” Le [...] examine alors le [...] et lui demande : "Lève-toi un peu, pour voir ?” Et il s'exclame :“Mais non ! crétin ! pas derrière ! devant !”
Le rire est communicatif et l’on rit ensemble d’un autre contre qui et grâce à qui se fait et se soude l’unanimité et l’unité des rieurs (soudure physique, solidarité qui s’observe, par exemple, quand un groupe d’enfants qui se moquent d’un adulte, pouffant et se détournant, l’un d’eux montrant du doigt, se forme en un cercle resserré, dos au ridicule). Rappel inversé des “communs” et de la koinè, cérémonie sociale de la réfection de l’unité sociale et de la remise en ordre des ordres, le rire est l’art de redécouvrir les fondements avec le plaisir de l’enfance. Pour filer une image primitive, on pourrait dire que, de même que les cellules du corps sont histocompatibles, les antigènes tissulaires causant le rejet du corps étranger (et du greffon), de même, le rire “immunitaire” (de protection) du chatouillement enseignerait et réaffirmerait l'unité corporelle, tandis que le rire du super-organisme qu'est le groupe sanctionnerait la socio-compatibilité de ses membres. Je ris : j'apprends le corps ; je ris : j'apprends le groupe (Provine et Fischer, 1989, ont judicieusement souligné, alors que la tradition philosophique focalise la réflexion sur le rire cognitif, la fonction de contact entre les membres d'un même groupe d'un rire sans autre raison que l'assentiment du contact et le plaisir de faire bande) ; je ris : j'apprends la vérité. Chorus (silencieux) des cellules : cœnesthésie ; rire bruyant du chatouillement et de la culture : expérience des limites du corps (C'est bien moi !) et de la corporation (C'est bien vrai ! ...que c'est faux), apprentissage et réassurance des êtres sociaux que nous sommes, de la contenance et du quant à soi, de la vérité et de l'erreur. Hyperesthésie plaisante de la ratification des limites.
... /...
|