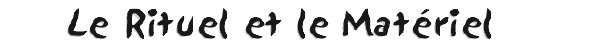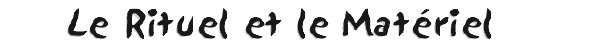|
Chapitre 16
Droit au sol et mythes d’autochtonie
IV - 16
En cette occasion de rencontre entre les disciplines, j’aimerais présenter quelques questions de nature anthropologique sur cette “image fabriquée de l’identité” où se revendique une sorte de consubstantialité du sol et du soi. Je vais donc égrener un certain nombre d’exemples dont l’objet est de montrer à la fois la faible valeur descriptive des mythes d’autochtonie et leur forte charge émotive. Avec cet “égrenage”, dont l’unité est plus formelle qu’essentielle, je me place dans une perspective aporétique : je me bornerai à mettre en évidence cette contradiction entre la vérité objective et la vérité subjective. Sans chercher à l’interpréter.
Dire qu’il y a une signification anthropologique du “territoire” et de l’autochtonie, c’est dire qu’on peut trouver dans le rapport que les différentes cultures, les différentes formes d’humanité, peuvent entretenir avec le sol un invariant. Que serait donc cet “invariant” ? Je prendrai comme indice le fait que, dans le monde “désenchanté” qui est le nôtre – je reprends bien sûr l’expression de Max Weber – où tout paraît “square”, cadré, orthonormé, le rapport au sol s’exprime souvent en des termes qui sont rien moins que rationnels.
Premier exemple. Un “point de vue” paru dans le journal Le Monde du 25 mai 2001 à la rubrique “Horizons-Débats” (quand j’étais en train de préparer cette communication). Il est question dans ce point de vue de territoire et d’identité à propos du transfert éventuel de la “loi littoral” vers la collectivité territoriale corse. Sous le titre : “Nous, les sentinelles de la terre de Corse”, l’auteur s’emploie à ouvrir les yeux de ceux qui soupçonnent les Corses de vouloir bétonner leur littoral. Il explique : “Notre relation avec la terre corse est tellement puissante et mystérieuse que nous saurons protéger avec constance nos côtes, mais aussi nos montagnes auxquelles il convient de réinsuffler vie et jeunesse. Sachez que nous ne nous considérons pas comme les propriétaires de ce sol, mais seulement les dépositaires. Nous sommes imprégnés de l’idée que nous devons défendre à tout prix cette terre sacrée que nous remettrons à nos enfants”. Cette profession de foi se termine par la dénégation suivante : “Notre patriotisme ne repose pas sur des termes creux et ronflants […]”.
Avec cette dénégation de l’emphase à laquelle la relation à la terre donne ou donnerait lieu, nous voici, me semble-t-il, dans ce registre spécifique que je cherche à caractériser. Si l’on fait crédit au vocabulaire utilisé avec récurrence en ces circonstances, quand le sol consubstantiel est en cause, on touche ici au “sacré”. Au-delà de la métaphore. Taïwan est ainsi, par exemple, la “province sacrée” du communisme athée de la Chine. Habiter serait donc une affaire religieuse et non une affaire profane. L’institution religieuse semble exprimer ce droit antérieur au droit qu’est la légitimité sur le sol en ritualisant la prise de possession du sol. J’ai à peine besoin de rappeler qu’une justification donnée par les islamistes aux attentats qui viennent de frapper les États-Unis serait la présence, depuis la guerre du Golfe, de soldats américains, d’infidèles, sur la terre sacrée de l’Arabie saoudite. Ce qui constitue une “humiliation” et une “souillure”. Le conflit israélo-palestinien est, lui aussi, un conflit théologique avant d’être un conflit politique… Comment une médiation politique est-elle possible entre deux communautés qui ont une relation théologique – i.e. exclusive – aux mêmes lieux ? L’inaliénabilité et la consubstantialité du sol et du soi s’expriment donc par l’autel, par le temple, par la mosquée (dans le “frisson sacré” de l'appartenance) avant de s’exprimer dans le droit.
Des justifications du droit au sol
Quelle justification avons-nous pour articuler le droit du droit : le bon droit, s’agissant de territoire ? Le plus simple, le plus évident, le plus commun c’est de mettre en avant le “droit du premier occupant”. On connaît la fable de Jean Lapin, délogé par une belette qui met à profit son insouciance nocturne pour s’installer chez lui et qui justifie sans états d’âme cette occupation sans titre :
La Dame au nez pointu répondit que la terre
Était au premier occupant.
C'était un beau sujet de guerre
Qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant.
Et quand ce serait un Royaume
Je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi
En a pour toujours fait l'octroi
À Jean fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume,
Plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi.
Jean Lapin allégua la coutume et l'usage.
Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis
Rendu maître et seigneur, et qui de père en fils,
L'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis.
Le premier occupant est-ce une loi plus sage ?
Il y a là évidemment un clin d’œil de La Fontaine politique – que je n’ai malheureusement pas le temps de commenter. La justification la plus commune, en effet, c’est de dire qu’on est là “à bon droit”, parce qu’on est là depuis toujours. C’est vraisemblablement ce qui s’exprime, éventuellement en termes non creux et non ronflants – et néanmoins non profanes – quand on qualifie la relation au sol natal : on fait corps avec lui.
Mais qu’est-ce qui nous prouve que nous sommes bien chez nous et de chez nous ? Très largement une forme généralisée de l’usucapion. Nous sommes là à bon droit, parce que cette propriété n’est pas contestée. Mais cette propriété s’argumente d’abord comme un propre, une aséité.
Le mythe grec de l’autochtonie (chthonios : qui est sous terre) donne une bonne illustration de ce type de construction qu’on voit prospérer dans les forgeries identitaires. Le bon droit s’y exprime par le fait d’être né du sol, de faire corps avec la terre. Nés de la terre, c’est ainsi que les anciens Athéniens se représentaient. La tradition faisait remonter la généalogie d’Erichthonios, l’un des premiers rois d’Athènes, au dieu souterrain, Héphaistos. Le dieu boiteux ayant reçu Athéna dans sa forge, venue lui commander des armes, se prit d’amour pour elle. La déesse échappa à son étreinte, mais, dans la lutte, la semence du dieu se répandit sur le sol. Ainsi fécondée, la terre produisit un enfant que la déesse recueillit et qu’elle confia, enfermé dans une corbeille en osier, aux filles d’un roi de l’Attique. Poussées par la curiosité, celles-ci ouvrirent la corbeille et virent l’enfant gardé par deux serpents. Selon certaines versions, c’est l’enfant lui-même qui avait le corps terminé par une queue de serpent – comme la plupart des êtres chthoniens… C’est “l’égalité dans l’origine”, l’isogonie qui, selon Platon (Ménéxène, 238 d-239 a), fonde la démocratie : “Ni l’infirmité, ni la pauvreté, ni l’obscurité de la naissance ne sont pour quiconque une cause d'exclusion, non plus qu’une extraction contraire un titre d'honneur, comme c’est le cas dans d'autres cités. Une seule règle fait loi : à l’homme réputé capable ou honnête l’autorité et les charges ; et la cause de ce régime politique est chez nous l’égalité de naissance. Les autres cités sont constituées par des populations de toute origines et formées d’éléments d'inégale valeur, d’où résulte l’inégalité au principe de leurs gouvernements, tyrannies et oligarchies ; les gens y vivent, un petit nombre regardant le reste comme des esclaves, et ces derniers en tenant les autres pour des maîtres. Nous et les nôtres, à l’inverse, tous frères nés d'une même mère, nous ne nous croyons pas les esclaves ni les maîtres les uns des autres. L’égalité d’origine, établie par la nature, nous oblige à rechercher l’égalité politique établie par la loi et à ne céder le pas les uns aux autres qu’eu égard à la réputation de vertu et de sagesse.” Cette égalité dans l’origine, c’est l’autochtonie. Dans le style propre au panégyrique, alors qu’il s'agit d’honorer la mémoire des soldats morts à la guerre et d’associer l’exhortation aux vivants à l’éloge des défunts, le (pseudo) discours d’Aspasie, rapporté par Socrate, développe le motif universel qui unit les morts et les vivants, celui de la terre mère (“cette terre sur laquelle ils vivaient” et où “ils reposent aujourd'hui” - 237 c). Si Platon choisit de traiter ce thème, c’est qu’il devait constituer un poncif des orateurs dont il moque l’enflure. C’est bien entendu ce caractère de poncif et cette enflure qui nous intéressent ici. L’autochtonie athénienne se démontre donc par le fait que l’Attique, quand les autres contrées se peuplaient d’“animaux de toutes espèces”, “enfanta l’homme”, puis les aliments, tels “le fruit du blé et de l’orge”, nécessaires à sa survie, “démontrant [par cette attention] que c'est bien elle qui a enfanté cet être”. “Car ce n'est pas la terre qui a imité la femme dans la conception et l’enfantement, mais la femme qui a imité la terre”(238 a)... Les “ancêtres [des morts dont on célèbre la mémoire] n’étaient pas d’origine étrangère”, ils ne sont pas “des immigrés dont les aïeux seraient venus d’ailleurs, mais bien des autochtones” nourris, non par une “marâtre”, mais par leur mère. (237 b-c) La fidélité à la terre est un devoir de fils.
Les Étrusques, eux, démontraient leur autochtonie par le surgissement de leur législateur, Tagès, du sol étrusque. Un paysan de Tarquinia, labourant son champ, vit un jour sortir du sillon un enfant qui avait la sagesse d'un vieillard. C’est à cet émissaire chthonien qu’est due la révélation du code de la religion étrusque, l'Etrusca Disciplina.
Les preuves que les peuples articulent pour justifier leur autorité sur le sol sont souvent de cet ordre, largement mythiques. Quant à l'histoire, le Ménéxène – certes à la fois un pastiche et une charge contre la grandiloquence dont les discours identitaires sont le prétexte – fait voir comment la passion patriotique est en mesure de la rendre. Pourquoi les “sonneries aux morts” et les hymnes nationaux, qui font lever les assistants et découvrir les têtes, autorisent-elles une telle révision ? Vraisemblablement parce que la cohésion physique du groupe propre à ces moments sacrés requiert un investissement émotionnel contraire à l’exercice de la froide raison. Plutôt qu’un manque de vigilance de la critique philologique qui a longtemps vu dans le dialogue platonicien en cause un modèle du panégyrique et non une parodie, c’est peut-être l’inhibition de tout esprit critique, dès qu’il est question de territoire, qui est ici significative. L’intention platonicienne est pourtant dénuée d’ambiguïté, tant les libertés d’Aspasie avec l’histoire sont flagrantes. La conclusion de ce panégyrique n’est pas moins étonnante, quand l’ethnolâtrie et l’histoire rêvée défient à la fois la prétérition et l’hyperbole : “Telles sont les actions des hommes qui reposent ici et des autres qui sont morts pour la patrie. Celles que j’ai rapportées sont nombreuses et belles, mais beaucoup nombreuses encore et plus belles celles que j’ai omises, plusieurs jours et plusieurs nuits ne suffiraient pas à les citer toutes”. (Ménexène, 246 a)
La valorisation de la langue maternelle peut être de cette nature quand elle est supposée exprimer un rapport indicible à la terre. On sait que Maurras faisait de la sensibilité au vers de Racine la pierre de touche de la nationalité française. Hérodote raconte qu’un souverain égyptien voulant savoir qui étaient les premiers occupants du sol prit un enfant en bas âge et le fit élever isolé du monde par un berger qui avait interdiction de lui adresser la parole et de s’exprimer devant lui. Quelques années plus tard, le roi fait revenir l’enfant à la cour. Et celui-ci se met à articuler un mot : “becos” qui signifie “pain” en phrygien. On en conclut évidemment que les Phrygiens étaient les premiers occupants du pays...
L’Homme de Cheddar
Voici un contre-exemple tout à fait exceptionnel qui démontre une autochtonie qui va bien au-delà des quatre quartiers. La ville de Cheddar, au sud-ouest de Bristol, dans le Somerset, est célèbre pour son fromage, le fameux cheddar. Elle est aussi célèbre par la découverte, en 1903, du squelette d’un chasseur vieux de 9 000 ans dans une caverne paléolithique, squelette dit de “l’homme de Cheddar” (qui peut être admiré au muséum d'Histoire naturelle de Londres). Dans le cadre d’une recherche de génétique des populations dont l’objet était de savoir si les hommes paléolithiques et les habitants actuels avaient une parenté génétique, le professeur d’histoire de la ville a eu la surprise d’apprendre, grâce à la comparaison avec le sien de l’ADN mitochondrial qu’on a réussi à prélever sur le squelette, que l’homme de Cheddar était son parent direct. Et qu’en neuf mille ans, il n’avait fait que quelques centaines de mètres.
L’Homme de Kennewick
L’affaire est beaucoup plus compliquée avec l’homme de Kennewick – affaire pendante devant les tribunaux américains qui oppose les représentants d’une communauté amérindienne et un groupe d’anthropologues.
Les faits. Un squelette enseveli sous une berge de la rivière Columbia, près de Kennewick, dans l'État de Washington a refait surface en juillet 1996 à la suite de pluies torrentielles. Un crâne est d’abord découvert et la police alerte un spécialiste des enquêtes d'identification judiciaire, anthropologue et médecin légiste à la fois, qui conclut qu’il pourrait s'agir, vu l’ancienneté du crâne d'un “colon européen”. Mais après avoir récupéré le reste du squelette quelques jours plus tard – celui d'un homme de taille moyenne, âgé de 40 à 55 ans –, il note la présence d'un fragment de pointe d’une flèche en pierre fiché dans l’os du bassin. Comment expliquer qu'un colon ait été blessé par une arme aussi rudimentaire ?… Un test au carbone 14 révèle une datation pour le moins inattendue : l'homme de Kennewick a 9 200 ans. On n’est donc pas en présence d’un “coureur des bois”. Ce qui fait problème, c’est que les caractères anthropologiques de l’homme de Kennewick ne sont pas “mongoloïdes” et qu’il ne s’agirait donc pas d’un amérindien. Ce constat, les analyses d’ADN n’ayant donné aucun résultat (et sachant qu’elle n’en donneront vraisemblablement aucun, le squelette ayant été “lavé” par le ruissellement “dans les siècles des siècles” a-t-on envie de dire, à la différence de celui de l’homme de Cheddar, retrouvé dans une grotte calcaire et dont l’ADN a pu être extrait d’une molaire), même s’il est sujet à discussion – les attributions morphotypiques n’ont qu’une valeur statistique – oblige à remettre sur le chantier l’histoire du peuplement de l’Amérique et, par voie de conséquence, à réinstruire la question des droits des Amérindiens en tant que “Premières Nations”.
La procédure judiciaire. En vertu d’une loi adoptée en 1991 par le Sénat, le “Native American Grave Protection and Repatriation Act” (NAGPRA), tout reste humain daté d’avant l’arrivée des Européens peut être revendiqué comme ancêtre par les nations amérindiennes et soustrait à la recherche scientifique. L'organisme gouvernemental qui gère le territoire où a été découvert l'homme de Kennewick revendique en effet le squelette au nom des Umatillas. Ces derniers, qui vivent sur les rives de la Columbia, le considèrent comme un ancêtre et ils ont l'intention de l'inhumer pour le soustraire aux scientifiques. Leur représentant, Armand Minthorn, argumente que “les politiques tribales interdisent les recherches scientifiques sur les restes humains des ancêtres des Umatillas”, celles-ci constituant “une violation des convictions religieuses profondes de son peuple”. Il y a là, aussi, des enjeux politiques. En effet, bien des Amérindiens craignent qu'une réécriture de l'histoire ne nuise à leurs revendications territoriales. Les prises de position de l’extrême-droite américaine donne quelque fondement à ces craintes. “Malgré tout le respect que j'ai pour les revendications autochtones, déclare un archéologue, certaines sont carrément aberrantes. Dire qu'un squelette de 9 000 ans vous appartient parce qu'il a été trouvé dans votre cour, ça va. Mais prétendre qu'en plus de vous appartenir il possède un lien de parenté avec vous est dénué de bon sens !” C’est pourtant toute la question – que j’essaie d’exposer ici avec cet exemple extrême.
Je dirais, pour en finir avec l’Homme de Kennewick, que ce débat illustre la différence d’approche entre la représentation (et la revendication) d’une sorte de lien mystique avec le sol et la représentation scientifique, profane et profanatrice, qui vise à reconstituer l’environnement historique et humain d’un squelette impersonnel . Entre la vérité subjective et la vérité objective.
L’autochtonie et le droit
Que signifie l’autochtonie aujourd’hui ? Quel statut juridique accorder à cet “imprescriptible” dans un monde caractérisé par les migrations, le métissage et la coexistence des hommes ? Deux cas de figure apparaissent d’emblée. Celui des sociétés qui ont été colonisées, la colonisation ayant prospéré sur la négation ou la subordination de tout droit antérieur en vertu de la doctrine de la terra nullius [vide supra : chapitre 15, pour la Nouvelle-Calédonie] ; et celui des sociétés libérales où l’autochtonie fait l’objet d’une dénégation juridique princeps. Deux exemples.
Premier cas de figure : le statut des aborigènes en Australie où la doctrine coloniale de la terra nullius a prospéré jusqu’en… juin 1992. Le revirement de jurisprudence constitué par l’arrêt Mabo (Mabo and others v. State of Queensland, 107 ALR 1) qui déclare qu’une concession consentie par la Couronne ne conférait à son bénéficiaire qu’un simple droit d’usage et n’éteignait pas les droits fonciers traditionnels des populations indigènes (“native title”) est d’autant plus significatif que la Haute Cour Fédérale a fait œuvre normative en renversant un ordre juridique établi depuis plus de deux siècles. En effet, à la différence du Canada, avec la Proclamation Royale de 1763, ou de la Nouvelle-Zélande, avec le traité de Waitangi de 1840, la Fédération australienne, l’ancienne colonie pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud, n’avait jamais reconnu l’existence d’une population sur le continent avant la prise de possession par la Couronne Britannique. Cette absence d’actes bilatéraux originels – sur lesquels le juge canadien ou néo-zélandais peut s’appuyer – donne tout son sens à l’arrêt Mabo puisqu’il crée du droit ex nihilo, reconnaissant à la communauté aborigène un statut en conformité avec le référendum de 1967. L’arrêt Mabo a mis en place les fondements juridiques d’une politique autochtone. Il a mis fin à ce qu’on a pu considérer comme un apartheid de fait – la théorie de l’extinction des Aborigènes qui a perduré jusque dans les années 50 rendant inutile un apartheid institutionnalisé – appuyé par une politique d’assimilation forcée. Ce sont, notamment, les “générations volées”, ces enfants aborigènes placés dans des familles d’accueil blanches (de 1880 à la fin des années 60, 40 000 à 60 000 enfants ont ainsi été enlevés à leur famille) pour lesquelles le pape Jean-Paul II va officiellement demander le pardon de l’Église. Dans son exhortation apostolique, Ecclesia in Oceania, faisant référence aux pratiques missionnaires d’enlèvement d’enfants ayant contribué à des “injustices historiques”, le pape déclare que “l’Église soutiendra la cause de tous les peuples autochtones qui cherchent à obtenir une reconnaissance juste et équitable de leur identité et de leurs droits”.
La légitimation des droits fonciers autochtones sous l’égide du principe de non-discrimination au sein de la communauté australienne met un terme aux politiques d’intégration forcée des minorités, mais elle va aussi au-delà. Le concept de “titre indigène” recouvre en effet bien autre chose que la stricte propriété de la terre :
“The expression ‘native title’ or ‘native rights and interests’, précise l’arrêt Mabo, means the communal group or individual rights or interests of Aboriginal people or Torres Strait Islanders in relation to land or waters, where :
a) the rights and interests are possessed under the traditional laws acknowledged, and the traditional customs observed, by the Aboriginal people or Torres Strait Islanders ; and
b) the Aboriginal people or Torres Strait Islanders, by those laws and customs have a connection with the land or waters ; and
c) the rights and interests are recognised by the common law of Australia.”
Sa reconnaissance, qui repose au regard du droit sur la réalité et la continuité d’un lien matériel et moral entre une communauté humaine et une terre (qui concerne donc des hommes qui, par l’effet “des lois et coutumes ont un lien avec la terre”, selon les termes de l’arrêt – l’évolution de la société traditionnelle ne signifiant pas “que le droit traditionnel cesse d’exister”), implique un dualisme juridique qui vaut reconnaissance, de manière réelle et non plus virtuelle, de la minorité aborigène. C’est le fondement constitutionnel d’un véritable statut aborigène. C’est l’acceptation d’une autre norme juridique coexistant avec le droit anglo-saxon.
Cette interprétation du droit au sol que je viens de présenter, liée à un choc de civilisations évidemment inégal, serait bien entendu impraticable et constituerait une contradictio in adjecto dans le droit des sociétés libérales [vide supra : chapitre 15]. L’antisémitisme politique illustre tragiquement cette impossibilité. C’est le deuxième cas de figure que j’ai retenu. Si le droit tel que l’entend l’antisémite Drumont, par exemple, opère une distinction stratégique entre la “Possession” et la “Propriété”, c’est pour réserver la propriété aux “autochtones”. Pour l’antisémite, c’est la légitimité qui procède du sol qui fonde le droit de propriété. Après en avoir appelé aux Pères de l’Eglise et à leur condamnation de l’usure, Drumont argumente :
“Aucun Chrétien ne peut confondre le capitalisme et la Propriété [...] Le capitalisme ressemble à la Propriété comme le sophisme ressemble au raisonnement, comme Caïn peut-être ressemblait à Abel. L’idée de propriété semble apporter naturellement avec elle, et indissolublement, l’idée de fécondité et d’utilité. Le type de propriété féconde, c’est la terre qui donne des fruits ; le type de la propriété utile, c’est la maison qui abrite. Le moulin, l’usine, la machine, sont des propriétés utiles, dans lesquelles est une fécondité latente que le travail met en œuvre. L’argent et l’or n’ont aucune fécondité par eux-mêmes [...] Ils n’ont qu’une valeur représentative [...] La Propriété est le droit à la possession d’une chose. La Possession séparée de ce droit a un air de famille avec la Propriété ; parfois on serait tenté de les confondre ; mais la première n’est en réalité qu’un fait matériel qui ne nous oblige nullement au respect [...] - Je possède parce que je suis légitimement propriétaire. Voilà la formule de la justice. - Je suis propriétaire parce que je possède même illégitimement. Voilà la formule de la friponnerie. Toute la question se résout donc, vis-à-vis du capital possédé par les juifs, dans l’origine légitime ou non de cette possession. Le fait qu’ils possèdent ne prouve rien. Ils peuvent être possesseurs de biens énormes sans être propriétaires en aucune sorte. L’habileté du voleur en effet peut lui donner la Possession : le travail seul confère la Propriété [...] L’origine de la fortune juive est l’Usure, sous toutes ses formes : le trafic, le brocantage, les spéculations de hausse et de baisse, les sociétés à prospectus mensongers, toutes machines inventées pour faire passer atome par atome les produits du travail chez les êtres improductifs. Le travail est la source de la richesse publique. A ce vase immense qu’alimente le travail, les juifs ont fait une fissure par où tout le liquide s’écoule constamment dans le tonneau de leurs caves. Cette grande fissure c’est l’Usure [...].” (La France juive devant l’opinion : 125-127)
La légitimité est donc dans le travail. Mais la représentation collective qu’en donne Drumont (le “vase immense” de la “richesse publique”) indique une légitimité plus archaïque, dont le principe n’est pas explicitement formulé ici et qui s’oppose à la spoliation de l’usure comme l’activité pastorale, pacifique et dévotieuse d’Abel s’oppose à la forge maudite de Caïn (selon une étymologie de ce nom) : la légitimité qui procède du sol et qui fonde le citoyen - “en vertu de [ses] droits de citoyen” - à demander à M. de Rothschild “ce qu’il a dans le ventre ou ce qu’il a dans sa caisse” (Ibid. :25).
Le champ ouvert par ces deux exemples montre l’élaboration d’un droit “flexible”, prenant en compte, certes, les “injustices historiques” mais œuvrant aussi à neutraliser ce donné problématique du rapport au sol. L'écart que l'on qualifie volontiers d'“évolutif” entre la culture aborigène et la culture libérale s’avère être un différend de représentation du monde – quant au “lien avec la terre”, précisément. Au fond, l’autochtonie paraît révéler, ou confirmer, que nous sommes, en quelque sorte, naturellement habilités à nous approprier, comme notre propre substance, notre environnement premier. (Ce qui relativise d’emblée le droit du premier occupant, au moins dès la deuxième génération. Et fonde, par exemple, le groupe beur “Carte de Séjour” à reprendre à son compte la chanson de Charles Trenet, au second degré bien sûr, mais aussi au premier : “Douce France / le pays de mon enfance…” Il y a là une duplique à la réplique que s’étaient vu opposer par les bourgeois de Paris des banquiers florentins qui souhaitaient acquérir la nationalité : que “nos monuments n’avaient point ombragé leurs berceaux”.) Mais que, dans un monde “plein”, cette appropriation ne peut être que contextuelle – voire symbolique. Quel statut donner à l’enracinement dans un environnement où prospèrent l’ubiquité et l’interconnexion ? La naissance fait-elle le droit ? Pourquoi telle nappe d’hydrocarbures, par exemple, devrait-elle appartenir “naturellement” à la famille Saoud plutôt qu’aux Inuits ? L’administration de la planète terre devra nécessairement imaginer des solutions juridiques adaptées à la co-location des ressources autant qu’à l’égale dignité des cultures et concevoir une charte de l’habiter préservant l’unité des droits qui procède d’une même appartenance à la famille humaine…
Après ce voyage assez large – et ce constat prospectif –, je vais terminer avec un exemple du cru pour montrer que les hommes ont beaucoup voyagé et que le droit est au sol est quelque chose dont il faut parler avec circonspection. Je n’apprendrai à personne ici que Moussais-la-Bataille, près de Poitiers, est la plaine où s’est vraisemblablement déroulée la bataille qui a permis à Charles Martel de repousser les conquérants Arabes en 732. Vous savez sans doute qu’un leader d’extrême-droite s’est tout récemment exprimé, au début de ce mois, en ce lieu symbolique de Moussais-la-Bataille, ce qui conforte mon propos – un autre s’était rendu, lui, au Mont Saint-Michel pour invoquer l’archange qui terrasse les dragons dans son programme de reconquête de la souveraineté nationale. Les hommes voyagent et les conséquences de ces voyages sont parfois étonnantes. La génétique historique et la génétique des populations s’intéressent à l’ADN, j’y ai fait allusion, notamment par l’analyse du sang et des systèmes d’histocompatibilité. Ce qui permet de retracer des migrations dont le souvenir, pourtant parfois consigné dans les manuels ou sur les monuments, s’est perdu. L’aire d’expansion de l’empire khmer peut ainsi être reconstituée par l’archéologie, mais aussi par l’hématologie : par la fréquence d’une structure moléculaire spécifique de l’hémoglobine, dite hémoglobine E, héréditairement transmise. Parmi les spécificités de l’hémoglobine (résultant de mutations qui peuvent avoir une signification adaptative : ainsi le gène de l’hémoglobine C conférerait-il une immunité au paludisme), celle connue dans littérature médicale sous le nom de drépanocytose ou “anémie à globules rouges à forme de faucille” (en grec, drépané : faux) résulte d’une mutation qui a vraisemblablement eu la péninsule arabique pour origine. Cette forme d’hémoglobine n’existe pas chez les Européens. En 1982, un Poitevin bien de Poitiers s’est curieusement révélé, à l'occasion d'une banale analyse de sang, être porteur de cette anomalie de l’hémoglobine. On ne donne pas les noms propres dans les communications scientifiques, je vais donc modifier son nom sans pour autant dénaturer l’information (je vais le dire sans le dire, car le patronyme est essentiel à l’affaire) : cet habitant de Poitiers s’appelait… Monsieur Sarrazin.
Qui donc, en vertu de quel droit au sol, de quel mythe d’autochtonie, pourrait dénier le droit au sol de Monsieur Sarrazin ?
(Communication présentée au colloque “Représentation de l’environnement et construction des territoires : dialogue des disciplines”, université de Poitiers, 11-12 octobre 2001.)
|