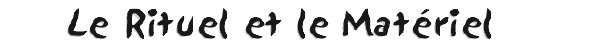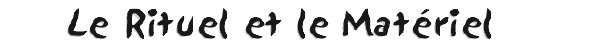|
|
|
|
|
Chapitre 9
La “culture des analgésiques” et l’individualisme :
quelques données pour une approche anthropologique et culturelle
de la douleur
III - 9
Dans ce colloque accueilli par la Faculté de médecine et organisé par la Faculté de droit, j’aimerais donner la parole, pour résumer le propos de ma communication, à un écrivain qui avait entrepris des études médicales (qu'il n'acheva pas) et qui exerça sur le Front : “Celui qui parvient à se représenter la souffrance des autres, écrivait Georges Duhamel, a déjà parcouru le difficile chemin de son devoir”. Si l’expression de la souffrance est un moyen de communication et le partage de la souffrance une consolation, et si notre individualisme a aussi les moyens pharmacologiques d’annuler ou de tempérer la douleur, alors ces moyens doivent nous rendre le même service - et davantage - que l’encombrant secours de l’importun prochain. Telle est l’idée que j’aimerais soumettre à votre critique.
La “ culture des analgésiques ” : j’emprunte donc ce titre à une parole d’évêque qui détonne dans les évidences d’aujourd’hui et dont voici la substance : “On ne peut effacer complètement la douleur sans enlever à la vie l’inquiétude nécessaire. La culture des analgésiques [...] nous rend incapables de supporter nos douleurs, incapables de comprendre et partager la douleur des autres”.
Ce sermon jure d’autant plus - prononcé devant une assemblée de cardinaux et d’évêques (le 13 octobre 1989 à Rome), il a d’ailleurs causé une certaine surprise - qu’il visait d’abord l’accouchement sans douleur et que, nous autres, croyons et tenons au progrès précisément parce qu’il nous affranchit des servitudes de l’espèce et qu’il fait notamment échec à la malédiction divine : “ Tu accoucheras dans la douleur ”.
Pour approcher le scandale de la douleur, et de la douleur infligée, il faut cerner, me semble-t-il, l’utilité - car il y en a une - l’utilité de la douleur. Utilité qui peut expliquer, comme le pose la citation que je viens de faire, le scandale de l’absence de douleur.
En réalité, tout jugement de valeur suspendu, je pense que l’expression “culture des analgésiques” qualifie une donnée fondamentale de la société occidentale moderne : l’individualisme et le droit de l’individu. Et que les deux verbes qui commentent cette expression : “supporter (nos douleurs)”, “partager (la douleur des autres)” définissent le champ anthropologique d’une réflexion sur la douleur.
Si la douleur ne se partage pas, si l’on ne peut se mettre à la place de celui qui souffre, c’est que la douleur exprime l’individuel par excellence. Et, de fait, la douleur banale est une affaire de peau : elle émane de cette enveloppe qui circonscrit l’unité individuelle et procède de ce sens tactile qui lui permet de se guider dans le milieu extérieur. Quand la douleur interne est diffuse, imprécise, la douleur-peau porte une information immédiate et explicite. Pour prendre une image très primitive, imaginons une amibe qui émet ses pseudopodes pour “ tâter le terrain ”. La douleur, message au système nerveux central, signale un contact et une voie impraticables. Elle renseigne, par conséquent, sur la conduite à tenir et la direction à prendre.
Pour changer de registre, mais selon des enjeux identiques : il existe un sens social du toucher qu’on appelle le tact. Le milieu n’est plus le milieu physique, c’est le milieu humain. Mais le tact, on le remarque immédiatement, est l’art, non pas de ne pas se faire mal en société, c’est ce savoir qui consiste à ne pas faire mal, au psychique et au moral s’entend, à son prochain. L’individu qui manque de tact est un être affligé de ce défaut de sensibilité particulière qui permet à l’homme d’évoluer parmi ses semblables. Cet être insensible se déplace dans le milieu humain comme s’il s’agissait d’un milieu matériel. Un milieu insensible. On voit par cet exemple que la douleur n’est pas seulement un message interne dirigé vers le poste de pilotage de l’unité qui se déplace dans un milieu extérieur. C’est aussi un message externe à l’intention du semblable.
Absolument individuel en cela qu’il est irrépressible, le cri de douleur se lance, même dans le plus total isolement, et lancer suppose une direction et un destinataire. La douleur tire à l’homme les plus forts signaux qu’il soit capable d’émettre. Pas seulement en décibels. La douleur fait donc partie des moyens de communication de l’espèce, selon une utilité qui n’est d’ailleurs pas l’apanage du monde animal, dit “sensitif”.
En septembre 1990 se tenait ici même, à Montpellier, un congrès international sur l’arbre. Un zoologiste sud-africain y exposa une étonnante - et fortuite - découverte : que les arbres communiquent entre eux et précisément quand ils sont soumis à une agression. Cet observateur du monde animal avait à comprendre pourquoi les antilopes en captivité des réserves du Transvaal mouraient sans cause apparente. Il s’est révélé que cette mortalité, pouvant atteindre 39 % de la population pendant la période hivernale, avait pour origine le tanin contenu dans les feuilles d’acacia dont se nourrissent les antilopes. Et que c’était là un moyen de défense des arbres qui, agressés par l’animal, augmentent le taux de tanin de leurs feuilles et qui, de surcroît, libèrent une substance volatile, l’éthylène, qui propage l’alerte et “prévient” du danger les arbres voisins. Ceux-ci, à leur tour, développent une toxicité mortelle aux animaux confinés derrière des clôtures et dont les pousses d’acacias constituent, l’hiver, la principale nourriture. Il suffirait de quinze minutes à un congénère situé dans un rayon de cinquante mètres pour multiplier par trois la concentration de tanin de ses feuilles...
La douleur est une alerte pour celui qui se fait mal et un moyen d’alerte à l’adresse du semblable. Pour prévenir, mais aussi pour partager, et bien que la douleur soit l’individuel par excellence. Car l’émotion, moyen de mettre la sensation individuelle en commun (l’émotion est par nature “touchante”), est aussi un moyen de partage de la douleur. On peut constater expérimentalement que, lorsqu’on projette un film d’horreur à un spectateur isolé, puis le même film au même spectateur en compagnie, il se révèle généralement aussi émotif et expansif en société qu’il pouvait être réservé et contenu en solitaire. Les signes de la douleur sont les plus communicatifs qui soient. Dans le visage de l’enfant défait par les larmes, quand se brouillent tous les traits de la contenance, il y a une imploration irrésistible, une communication qui s’opère par subversion des moyens de communication. Et l’imploration peut parfois dépasser son objet : s’épuiser en contagion. Comme le note avec quelque emphase l’obscur et immortel auteur d’une formule attribuée à Boileau (“Chassez le naturel, il revient au galop”), j’ai nommé Destouches, qui écrit :
“Car qu’une femme pleure une autre pleurera
Et toutes pleureront tant qu’il en surviendra.”

Douleur, Richard Aeschliman, 1976.
Le caractère vital de cette communication peut être marqué par le fait que certains des signes de la douleur et notamment ceux de la douleur morale, sont soustraits au contrôle volontaire. Par exemple, cet appel émis par ce que Darwin (1874 : 194-197) a proposé d’appeler les “muscles de la douleur” qui rident le front d’une manière tout à fait spécifique, qui sont mis en jeu, chez l’adulte, par l’angoisse morale, et que, sauf apprentissage, on ne peut mobiliser dans une intention de simulation.

*
Mais la douleur, à l’inverse du cri de détresse et de cet appel à partage – qui nous remémore que l’individu est aussi une rétraction d’un nous collectif et que le retour au giron de la communauté constitue une sécurité - précisément parce qu’elle exprime l’absolument individuel, est aussi un moyen de formation de l’individualité.
Dans la société traditionnelle, alors que nous élevons nos enfants, nous, “dans du coton” et cherchons à leur épargner toute douleur physique, l’éducation de la douleur constitue un passage obligé de l’éducation des jeunes gens. Et spécifiquement de l’éducation des garçons, selon des valeurs dont témoigne encore le langage commun. Le courage, identifié à la résistance à la douleur, est représentatif de la différenciation sexuelle : en avoir, c’est appartenir à la classe des hommes.
J’illustrerai cette éducation par cet extrait qu’Elisabeth Badinter donne, dans son Identité masculine (1992 : 115-117), des rites d’initiation chez les Bimin-Kuskumin de Nouvelle-Guinée (in Herdt, 1982).
Burschenschaften
“Les Bimin-Kuskumin consacrent un temps et une énergie extraordinaires aux activités rituelles masculines. Elles ne comportent pas moins de dix étapes qui durent dix à quinze ans. Une fois enlevés à leur mère, les garçons (de sept à dix ans) écoutent les chants des initiateurs qui les désignent comme des êtres souillés, pollués par les substances féminines. Les garçons, terrorisés, sont déshabillés, leurs vêtements brûlés et ils sont lavés par des initiateurs femelles qui enduisent leur corps d’une boue jaune funéraire, tout en faisant des remarques désobligeantes sur leur sexe. Cette expérience humiliante est suivie d’un discours des initiateurs qui leur annoncent qu’on va les tuer parce qu’ils sont affaiblis et pollués par leur mère. Les enfants, extrêmement nerveux, commencent à pleurer et leurs cris redoublent lorsqu’on fait couler le sang de leur tête. On les montre une dernière fois à leurs mères qui pleurent, elles aussi, et prennent le deuil.
Les garçons sont emmenés plus loin dans la forêt et battus par surprise avec des baguettes jusqu’à ce que leur corps soit couvert de zébrures. Pendant les quatre jours suivants, ils sont humiliés et maltraités de façon presque ininterrompue. Les traitant constamment de “pollués” et d’avortons, les initiateurs alternent la flagellation aux orties brûlantes qui fait saigner le corps et les nourritures vomitives afin de les purger de tout le féminin accumulé depuis la naissance. Pour les [obliger] à vomir on leur ingurgite de force du sang et de l’urine de porc. Le traumatisme de la douleur et la puanteur des vomissements incessants, la saleté, les cris et la terreur ressentie, mettent les enfants dans un état physique et psychique d’extrême misère. À peine cette première épreuve terminée, on les force à manger des nourritures “femelles” interdites qui accentuent leur panique et provoquent de nouveaux vomissements. Après un répit de quelques heures, les initiateurs les incisent au nombril (pour détruire les résidus menstruels), au lobe de l’oreille et brûlent leur avant-bras. Le sang récupéré est ensuite appliqué sur leur pénis. On leur dit que ce sang (féminin) va dissoudre leur pénis et on les humilie quand celui-ci se rétracte au contact du sang.
Aux yeux de l’anthropologue qui a observé ces événements, les enfants sont alors dans un état de choc indescriptible. Beaucoup, le corps en sang, s’évanouissent ou deviennent totalement hystériques. C’est le moment choisi par les initiateurs pour leur annoncer qu’ils sont en train de mourir... Puis on les soigne, on leur donne un nom masculin, tout en continuant à leur faire régulièrement des incisions sur les tempes. En dépit des premiers soins des aînés, les novices restent prostrés en état de détresse et de peur.
Porter Pode a interrogé novices et initiateurs sur leurs sentiments personnels durant ces épreuves [...] Il a demandé aux anciens si tant de tortures ne les touchaient pas. Beaucoup lui ont dit leurs regrets de ces souffrances. Mais ils les jugeaient nécessaires pour les garçons [...] Tel est le prix à payer pour passer d’un état de vulnérabilité femelle à celui de mâle puissant [...] Les novices lui ont confié leur profond désespoir, fait de rage, du ressentiment d’avoir été trahis par leur mère qui ne les a pas protégés, et d’hostilité pour leur père complice de leurs tortionnaires. Mais la plupart des novices ont également dit leur orgueil d’être passés par là et d’avoir survécu [...] Ils disent que quelque chose s’est cassé en eux. Ils ont coupé le cordon ombilical et ressentent une nouvelle solidarité masculine. Celle-ci est constituée par un pouvoir non contesté et par la séparation du danger féminin.“
J’aimerais faire écho à cette description “exotique” par un cas beaucoup plus proche, celui du passage de l’étudiant Max Weber dans ces Burschenschaften, corporations d’étudiants où l’affiliation constituait un ticket d’entrée aux carrières futures et où se trouvaient mêlés des rites d’inspiration maçonnique et des rites beaucoup plus archaïques. Max Weber reçut de la sienne, à Heidelberg, les Schmisse, ces balafres qu’il dissimulait sous une barbe et il pourra dire qu’il avait acquis là des “automatismes comportementaux dont il a eu des difficultés à se libérer”.
Si l’éducation par la douleur nous apparaît comme un concept et un outil pédagogique dépassé, un archaïsme barbare, faut-il voir une relation entre la “culture des analgésiques” et la culture de l’égalité des sexes qui caractérise la société libérale ?
L’idéologie de la différence des sexes a d’abord pour objet de former le courage physique et la bravoure, la fonction sexuelle du mâle étant primitivement associée à la défense du territoire et sa pertinence génitale à sa capacité, au terme d’un processus de différenciation ritualisé, à faire face à la sexualité féminine pour jouer sa part dans la reproduction. À l’opposé de cette sexualité “naturelle” commandée par un éthotype territorial et familial, la société libérale développe des valeurs idéalement affranchies des contraintes locales et des nécessités reproductives. Y a-t-il plus démodé, aujourd’hui, que la religion de la patrie (terre des pères) ? Et plus insupportable que le “machisme”, qui représente pourtant une forme, surannée sans doute mais achevée, de la différence des sexes ? Y a-t-il plus “dépassé” que la morale qui entendait faire honte à la déviance sexuelle et à l’homosexualité ?... Cette obsolescence se signalant structurellement par la substitution du culte de la “Filisterie” (Gombrowicz) au culte de la Patrie (infra, chapitre 11).
Ce renversement disqualifie, bien entendu, la violence pédagogique caractéristique des sociétés initiatiques et des sociétés à classes d’âge en même temps que l’éducation de l’insensibilité qui forme à la défense du territoire. La construction de la notion de “sexe psychique” est l’aboutissement, après la dépénalisation de l’homosexualité, d’un ordre juridique et social où :
- la maîtrise des signes monétaires concurrence ou se superpose à la maîtrise territoriale ;
- la défense du territoire devient une spécialisation professionnelle (l’homosexuel n’étant pas déplacé dans l’armée de métier ) ;
- la neutralisation des fonctions engage la neutralisation des genres et la réforme de la grammaire ;
- la procréatique supplée ou supplante les stéréotypes qui induisent au rapprochement sexuel : est-il toujours aussi nécessaire, pourrait-on dire en simplifiant le trait, maintenant qu’on sait faire les enfants in vitro, de tout miser sur l’enseignement des poncifs culturels de procréation in vivo ?
- le comportement sexuel est supposé résulter d’un libre choix au même titre que la liberté de conscience, tel qu’on pourrait répondre du sexe d’un enfant à la question : “C’est un garçon ou c’est une fille ?” en disant, comme ces parents qui répugnent à donner une éducation religieuse : “ Il fera bien comme il voudra ! Il décidera lui-même quand il sera en âge de choisir ”. (Un procureur ayant requis dans une affaire de pédophilie, diteToro Bravo, en 1997, explique : Il faut “laisser aux adolescents le temps de choisir, d’hésiter […]”) La psychologie habilite la singularité sexuelle sous le sceau moral de l’absolument individuel : authenticité acquise dans l’isolement de la jouissance, quand la douleur intègre par anéantissement de l’identité ;
- où l’intérêt individuel est le “seul surintendant de l’industrie des particuliers” (Adam Smith). Ce qui est marqué du signe de la dette et du devoir : l’appartenance à une terre, à un corps d’égaux, à une lignée étant moralement dévalué, au profit du crédit et de la jouissance.
La néo-modernité : de l’environnement naturel à l’arraisonnement technique, l’homme maître et possesseur de sa propre nature : de sa niche écologique à sa niche égologique, a pour corollaire la scotomisation du mal et pour vocation la capacité à anesthésier la douleur. La fiction d’une terre sans mal s’entretient du mirage d’un corps sans affliction.
Ainsi la médialangue, qui trouve à la télévision sa terre de mission d’élection, censure-t-elle le mal comme la novlangue censurait naturellement la critique. On ne dit plus “un aveugle” mais “non-voyant”, “un nain” mais “une petite personne”, “un sourd” mais “un mal-entendant”. Et la pédagogie moderne a définitivement renvoyé à la préhistoire de l’éducation les “cancres”, “crétins” et autres incorrigibles “imbéciles” qu’elle a changés en de perfectibles et auspicieux “hétéro-comprenants”. L’effet est un peu facile, je le reconnais… Mais il signale le caractère systématique d’une euphémisation qui n’a plus pour but d’accommoder la douleur, mais de lui dénier toute réalité et toute signification.
*
Ce refus de voir le mal, joint à la capacité d’anesthésier la douleur, entretient-il une insensibilité à la souffrance d’autrui comme il est dit dans le sermon que j’ai cité ?
Si la douleur induit une mise en communication, un partage et une consolation, le pouvoir de supprimer la douleur par des moyens internes fait peut-être d’autrui un gêneur inopérant : pourquoi me remettre entre les mains du prochain quand le Tranxène (chlorazépate dipotassique, appartenant à la famille nombreuse et prospère des benzodiazépines), le Prozac (fluoxétine), les analgésiques périphériques (de type paracétamol : Doliprane, Efferalgan, Dafalgan…) (ou la péridurale, précisément) - pour ne pas parler des antidépresseurs : inhibiteurs de la mono-amine-oxydase, de la recapture de sérotonine ou de la recapture de sérotonine et de noradrénaline, IMAO, ISRS ou IRSNA -, me rendent le même service, sans s’immiscer dans ma vie privée - et me rappeler du même coup une dette à la nature et à la communauté ? La dépendance aux analgésiques serait moins contraignante que l’addiction à la société. La pharmacologie répond peut-être à l’éthos moderne comme l’humanité répondait à l’éthos traditionnel - quand c'est la compagnie, comme l'indique l'étymologie, qui est parégorique, qui console…
J’ai commencé par une parole d’évêque, je voudrais finir, pour relier ces considérations générales à ce qui sera examiné ici : “obtenir par la douleur”, par la parole proverbiale d’un imam :
“Quand Allah le veut, dit cette parole, le prisonnier enchaîne son gardien.”
Ceci ne signifie évidemment pas que le prisonnier, profitant d’un moment d’inattention de son gardien - et avec la bénédiction d’Allah -, passe à son tour les chaînes à celui qui le tenait prisonnier. Mais, précisément, qu’il s’instaure, dès que deux humains sont mis en présence, une communication silencieuse qui témoigne d’une identité de nature et telle que, malgré la dualité et la séparation des corps, une même sensibilité est en jeu. De sorte que, la souffrance de l’un engage la compassion, la commisération de l’autre en affectant son humanité. Et que la faiblesse du faible, la situation de dépendance absolue du prisonnier peut - quand Allah le veut - dicter un devoir de protection au fort et faire de l’assujetti un maître...
Comprendre par quel processus l’homme peut se soustraire à cette humanité, tel est l’enjeu auquel ces remarques préliminaires souhaitaient introduire.
(Communication présentée au colloque “La douleur et le droit ”, Faculté de Médecine et Faculté de Droit de Montpellier, Montpellier, octobre 1995.)
|
|
|