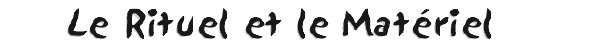|
IV - 12.4 Une peau de banane sémantique
 - Continuité sémantique et... - Continuité sémantique et...
Le sens se construit dans la durée, linéairement. Et, parfois, dans la douleur. Quand cela a du mal à sortir, il est manifeste que le sens résulte d’un travail : “Vas-y ! accouche !” ou encore : “Mets tout ça sur la table, on va démêler…” Ex-primer ce qu'on veut dire suppose l’application de l’esprit sur une matière qui paraît résister. Parler, c’est construire, en effet, sur l'axe horizontal des concaténations et sur l'axe vertical des substitutions, syntaxiquement et sémantiquement, une réalité qui n’existe pas et qui peut être communiquée.
Le sens admissible procède du respect de règles grammaticales appliquées à une description du monde vraisemblable, c’est-à-dire partagée par les locuteurs et auditeurs potentiels.
Dans la mesure où le sens est attendu, globalement annoncé (à tout le moins le registre de vraisemblance dans lequel il va se déployer) il est déjà là dans l’esprit de l'auditeur. Les règles grammaticales sont communes et l’expérience du monde aussi. Le sens qui vient d’être produit reste présent à l’esprit et compose avec le sens en production. Chaque phrase ajoute, nuance ou contredit… dans une continuité.
L’incorrection grammaticale évidente, de même que l’incohérence sémantique déclenchent une “stupeur” qui s'exprime chez l’auditeur non prévenu par l'émission de l'onde N400 (une variation négative de l’activité électrique cérébrale : plus le mot est inattendu, plus l’amplitude est grande : Kutas et Hillyard,1980). Patatras ! La ligne sémantique bute contre un mur.
Le cerveau, producteur de sens, est un extracteur de rythmes. Les proverbes ont souvent ce tour littéraire qui les marque en mémoire et qui les fonde en nécessité. Qui vivra verra. Traduttore traditore. Enseigner à un enfant, c'est graver dans la pierre ; enseigner à un vieillard, c’est écrire sur l'eau, dit un proverbe africain… Le coin du style, les figures de réthorique, la prétérition, l’emphase, le vers holorime (Gal, amant de la reine, alla, tour magnanime, galamment de l'arène à la tour Magne à Nimes), le palindrome (Esope reste et se repose), l’anagramme, le calligramme, l’acrostiche, le chiasme (Pascal inventait des problèmes de mathématiques pour faire passer ses maux de tête ; l'hétéro-comprenant invente des maux de tête pour faire passer ses problèmes de mathématiques… ; Poignez le vilain, il vous oindra / Oignez-le, il vous poindra : syntaxiquement, c'est un parallélisme : action = conséquence, phonologiquement, c’est un chiasme : “poindre” / “oindre”)… , tous ces exploits stylistiques ont la ligne en mire quand ils dévient de la ligne. Leur tour de force est de quitter le fil et de rester sur le fil, d’entrelacer des figures qui, dans leur légèreté, dans leur apparente désinvolture, rendent hommage à la nécessité linéaire, à la gravité qui, avec la contention de la visée significative composent le sens. Ces prouesses produisent des “Aah !” (silencieux) et non des rires (ah ! ah !). Autrement dit, des surprises, non pas de type N400, des incorrections, des incongruités ou des incongruences, mais des “surcongruences”, de la surdétermination : du sens en surcroît et non un défaut de sens. Les figures stylistiques révèlent l’activité métalinguistique, la récursivité de la langue, la capacité de l’esprit à penser ce qu'il pense. La polyphonie, ou polysémie, est le propre de l’homme.
Comme la navette du tisserand, la parole tisse, en effet, des liens entre les éléments épars du monde. La langue n’est pas un simple miroir, un lexique qui cataloguerait les objets. Sans la parole, les objets du monde resteraient orphelins... C’est la parole qui apparente, transporte et transpose, étymologiquement : métaphorise. L'esprit joue, non seulement de l'homophonie, de la réverbération sonore, mais aussi de l’identité qu’il décèle dans la diversité des registres de l’expérience. Comparer fleur et jeune fille, vieillesse et terre craquelée..., c’est voir l’unité des formes dans la diversité des expressions. C’est totaliser les expériences du monde en une seule ; c’est humaniser le monde. La polysémie sort de la forge de l’esprit. “L’homme habite en poète”, disait Holderlin. Cette polysémie, que les logiciels de traduction, faute d’une expérience du monde, ne maîtrisent qu’imparfaitement (e. g. ouvrir un judas – pour voir ce qu’il a dans le ventre, ou pour lui faire la peau ? ravaler une jalousie, entrouvrir un œil de bœuf, grimper sur un chien assis...), toute cette “profondeur” dans le trésor de la langue, ces “trous creusés par des générations de fourmis”, selon le mot de Baudelaire, manifestent la plurivocité foncière du génie humain. C’est bien entendu le contexte qui permet de savoir si mon voisin de paillasse est un compagnon d'infortune ou un collègue de laboratoire (les deux, peut-être...). Quand donc je dis que l’idiot du village a été inculpé d'intelligence avec l'ennemi, je n’énonce pas une contradiction et une absurdité, j’énonce un non-sens qui a du sens, je fais preuve de la finesse (toute relative, j’en conviens) de celui qui sait qu’il y a intelligence et intelligence … Ce n’est pas le contraire du vrai, c’est une vérité métalinguistique. Quand la rupture n’est qu’un bruit, elle dérange bêtement. Quand elle a du sens et qu'elle met le (bon) sens en question, elle fait rire.
 - ... rupture sémantique - ... rupture sémantique
L’histoire drôle est donc un dispositif de rupture significative d’autant plus efficace que le changement de niveau sur lequel il est construit est plus marqué, notamment lorsqu’il y a une opposition structurale entre le point de départ et le point de chute (la chute). Voici un exemple (très “classe”) de cette opposition structurale. Un homme s’attable dans un restaurant et le serveur lui propose le menu du jour : de la langue de bœuf. - Merci, répond le client, mais je n’aime pas ce qui sort de la bouche des animaux. Donnez-moi plutôt deux œufs… (Autre exemple, l’opposition “derrière” et “devant” exposée précédemment au titre de la “blague ethnique”, illustrant de surcroît l’opposition entre expression et excrétion, raillant “l’autre homme” avec son étron en panache.) Vous entraînez l’auditeur dans une direction, l’établissez dans un système de référence puis, à la faveur d’une polysémie que vous gardez en réserve (homonymie, homophonie, assonance, homologie, symétrie, chiasme...), vous l’obligez à appliquer la règle d’intellection de cette référence prémisse à cette réalité dernière - généralement triviale. La blague scatologique (ou sexuelle) exploite systématiquement cette opposition structurale entre l'idéel et le matériel, le psychologique et le biologique, dégradant électivement l'idéal dans le physiologique. Spencer remarque que le rire sanctionne la voie descendante, exclusivement, de cette amphibologie. C'est un couple d'amoureux qui s'isole dans la campagne et s'allonge dans l'herbe. Elle : Tu vois mon chéri comme tout est beau autour de nous : les fleurs, le ciel bleu... On dirait que tout vibre avec nous. Écoute ! il y a un petit oiseau qui vient de chanter, là, tout près... Lui : Mais non ! c'est le zip de ma fermeture éclair...
Ce n’est pas le rire, stricto sensu, qui est le propre de l’homme, c’est, comme l’explique Vico (vide infra), la polysémie. Les degrés de l’esprit s’évaluent banalement en fonction de la nature de cette polysémie.
Le calembour
Au bas de l’échelle, le calembour - “fiente de l’esprit qui vole” dit Victor Hugo, et désespérant, aussi, quand il est systématique : il dénie au langage toute fonction pragmatique - qui introduit dans une continuité significative une homophonie qui n’a qu’un rôle de “fausse fenêtre”, plaisante par cette seule réverbération sonore. Il n’y a ainsi aucune relation significative entre la gaieté et le guéridon qui est pourtant supposé la provoquer…Le modèle conceptuel du calembour pourrait être l'exploit du potache qui met bout à bout des mots authentiquement latins dont la succession n’a aucun sens, pour composer des phrases sensées (de préférence salaces) dans sa langue maternelle… du type : Cleopater certe cuis, Caesar latremens…(désolé !), (potache que, bien entendu, les fameux ...par trois fois en son sein, le fer a repassé, du malheureux Corneille ou autres Cicéron c'est Poincaré remplissent d'aise).
Exploit affligeant de nullité, donc, sauf à faire du calembour, à l’instar de Jean-Pierre Brisset, sacré “prince des poètes” par des amateurs de canular, le fondement de la langue et la voie d’accès à la vérité : “l’épée de feu qui [garde] le chemin de l'arbre de vie”.
“L'idée qu'il a pu y avoir quelque chose de caché sous le calembour, explique Brisset, ne pouvait venir à aucun homme car c'était interdit à l'esprit humain. Il lui était seulement imposé d'éclater de rire stupidement”, ce qui reste, d’ailleurs, “le partage des sots et des esprits bornés... ” (Les Origines humaines, 1913). Pour emprunter le chemin démiurgique du calembour et comprendre le sens originel des mots et de la parole, “il faut devenir comme un enfant” (La Science de Dieu ou la Création de l'Homme, 1900).
Exemple (et comment ne pas suivre Brisset lorsqu’il met en relation la station droite, la surrection de l’homme, et le surgissement de la parole ?) : “Tous les mots expriment dans leur idée première un ordre de se dresser, de s'élever, de se tenir droit. La parole élève l'âme. L'ancêtre se résolut difficilement, autrefois comme aujourd'hui, à marcher droit. Il eut besoin de nombreuses corrections pour prendre la corps-rection. Corps érige-toi, disait-on au rampant pour le corriger; corrige-toi. Je vais te corps ériger, te corriger. Il est bien corps érigé, corrigé. Dans maint dialecte on entendra encore le son é dans le mot corriger. D'ailleurs riger=ériger et dresser. Ai rigé=j'ai dressé. Ri vaut aussi droit, car rigé est formé de ri j'ai=j'ai ri, droit ou raide. Par conséquent le rire était provoqué par ceux qui voulaient se dresser et retombaient piteusement par terre. Je ris, je me ris valait : je me tiens droit et ce disant l'ancêtre retombait. - Je ris, je ris, criait l'autre en riant. C'est là l'origine du rire involontaire qui nous prend, alors que nous voyons quelqu'un tomber ridiculement. La bête rampante qui est en nous jalouse ceux qui s'élèvent et se gausse de leur chute : Patte à terre as, patatras !” (Les Origines humaines).
À la veille de la Révolution française, la brève carrière littéraire du marquis de Bièvre, le “calembourdier par excellence” dit un contemporain (De Baecque, 2000), est probablement davantage révélatrice, dans son système, de la fonction ordinaire du calembour. En 1770, l’invraisemblable succès de sa Comtesse Tation (Lettre à la comtesse Tation), qui justifie une quinzaine d'éditions, fait penser à une fièvre contagieuse. Georges de Bièvre devient aussitôt une des personnalités les plus en vue des salons, protégé de Louis XV qui le fait marquis. Il récidivera avec les Variations comiques de l'abbé Quille, une tragédie, Vercingétorixe (1770), et les Amours de l'ange Lure, roman historique (1772). Même si la fièvre retombe rapidement, le succès foudroyant de calembours aussi lamentables que : “De nos pères de bas imitons la constance”, “Ton image en moi sera peinte ou chopine”, “Je vais me retirer dans ma tente ou ma nièce” (Vercingétorixe) laisse songeur. Quand il écrit sa Lettre, Georges de Bièvre a vingt-trois ans. Il notera, dans une Dissertation sur les jeux de mots, philosophant sur cet art qui lui a valu une gloire éphémère (il sera sollicité par Diderot, en 1776, pour écrire la notice “Kalembour ou Calembour” destiné au Supplément à l'Encyclopédie), la relation entre la jeunesse et la frénésie des jeux de mots : “Les jeunes gens doués d'imagination, et dont le goût n'est pas encore formé, explique-t-il, sont presque tous éblouis par ces antithèses recherchées [...] Il en est peu qui, à leur entrée dans le monde, ne paient à la frivolité un tribut de quolibets”. Il y a, en effet, une sorte d'hébéphrénie dans cet usage mécanique du calembour, propre à l’“âge bête” nécessaire à l’apprentissage de soi, et largement hermétique pour qui a passé cet âge climatérique. La lecture de Vercingétorixe demande ainsi un temps d'accommodation, tant la production de calembours (un par vers, matérialisé par des italiques) y brouille l'expression, jusqu'à ce qu'il apparaisse que le calembour entre (conformément à la définition rappelée plus haut), non pas dans la construction de la ligne sémantique, mais dans sa destruction : c'est, en l’espèce, une rime ou une cheville, dans le genre “poils aux dents” de l'humour potache, une interférence qui vient redoubler phonétiquement le mot cible (“Mais plus que toi Sylvie est adroite en rentrant”, “Ne peux-t-on vivre heureux sans elle de dindon”, “Je méritais plutôt d'être plaint comme un œuf. / Pourquoi ce ton salé ? Prenez un air de bœuf”.) L’ado familier qui répète systématiquement la phrase que vous venez d’énoncer (y compris, bien entendu, celles qui le prient de cesser de faire le perroquet) s’installe dans une même dénégation de la communication, dans une production de sens qui ne vise qu’à la destruction du sens, le dire du rien. Cet investissement parodique de la langue n’est pas gratuit. Il exprime, sans doute, la maîtrise, ou l’exercice, du locuteur. Sa capacité de dérision éventuellement : Vercingétorixe est ainsi une caricature et une démystification de ces “gaulois” et de ce Tiers état supposé devoir reprendre le pouvoir aux aristocrates, ces descendants des francs qui les auraient subjugués... Mais, aussi bien, sa “frivolité” ou son impuissance, quand la réalité n’existe que pour entrer dans les jeux des mots et se plier au désir du “calembourdier”. Le marquis avait ainsi fait planter des ifs dans sa propriété, au nombre de six, afin de pouvoir dire : Voici l’endroit des six ifs... Vertige de l’âge, vertige des mots, vertige de l’histoire, aussi, qui va emporter dans sa tourmente “beaux esprits de cour” et “bretteurs de langue”. Le marquis est de la première émigration. Il décèdera en Allemagne en octobre 1789.
Bièvre illustre les derniers éclats d'une civilisation condamnée par l'histoire, mais aussi une manière de refus de la raison triomphante. Il est parfaitement conscient, dans sa Dissertation, de la différence entre le jeu de mots et le bon mot. Il explique en effet : “Lorsque la finesse d'une saillie ne consiste pas dans une équivoque, mais dans une idée ingénieuse, exprimée avec précision, ce n’est plus un jeu de mots, c’est véritablement un bon mot. Il n’en échappe qu’aux gens d’esprit, tandis que le jeu de mots est l’esprit de ceux qui n’en ont pas.” (Il citait dans sa notice pour le Supplément, à ce titre, le mot de Molière au parterre, le jour où le Président de Harlai, modèle supposé de Tartuffe, avait fait susprendre la représentation : “Messieurs, nous comptions avoir l’honneur de vous donner aujourd’hui Tartuffe, mais M. le premier président ne veut pas qu’on le joue”.) Bièvre n’en revendique pas moins la recette du jeu de mots et son effet : “Tantôt l’idée du calembour n’a pas l’ombre du bon sens, mais alors il n’en est que plus plaisant, parce qu’il transporte tout à coup l’imagination fort loin du sujet dont on parle, pour ne lui offrir qu’une puérilité piquante et curieuse.” (Supplément) Et affiche la “gaieté” contre les “tristes amateurs de l’esprit public” (“J'ai jugé que le calembour pourrait fort bien tenir lieu d’arme défensive contre ces ennuyeux personnages [...] Le goût du calembour n’est point une maladie chez moi, mais une ressource innocente pour repousser l’ennui et rappeler la gaieté.” ) ; la “frivolité” contre la “vanité des sérieux”. Davantage, il dénie à la raison et aux philosophes la capacité à expliquer le monde. “Inventeur de cet art très sublime de se passer d’instruction et de suppléer aux sciences par les calembours” (selon la publicité d’un recueil publié avant la Révolution où il est en vedette), il se pose, dans une lettre adressée à la Bibliothèque universelle des romans, en avril 1776, en sectateur de la “faction satyrique” contre le “complot philosophique”, sa “froide jactance” et sa vaine prétention à expliquer les mystères de l’univers, en “aiguillon du Parnasse français” contre le parler “rude et barbare” des “imitateurs des mœurs étrangères”. “Inutile, orgueilleux, fanatique, délirant, sérieux, bavard, prétentieux philosophe” : on voit que le marquis est “remonté” contre l’espèce... Alors qu’il est désormais interdit de faire des calembours en présence du roi (le serrurier ne les comprenait pas) et que la révolution éclate, il signe : “La révolution qui est en train de produire tant de changements n’a presque rien opéré sur le caractère français. Même frivolité, même goût pour le bel esprit. Paris, ce pays si fertile en contrastes, offre ce genre d’excès d’extravagance. Tandis que tout est en combustion, le Parisien joue sur les mots, et se console avec des calembours.” (Dissertation) Sans doute. Mais il y a des limites au pouvoir des jeux de mots et l’on pourrait opposer au marquis et à sa philosophie de l’accommodement par le rire une parodie de la réplique de Liancourt à Louis XVI : –“Non, marquis, ce n'est pas une comtesse Tation, c’est une Révolution !”
L’“inanité sonore” du calembour est parfois sauvée, précisément dans la mesure où s’y délivre un sens holorime : ainsi en ces vers, dus à Bobby Lapointe, qui développent une intéressante conception de la paix domestique : Mon père est marinier dans cette péniche / Ma mère dit : la paix niche dans ce mari niais... Parmi les héritiers du marquis, l’Almanach Vermot, sans doute, mais aussi, plus étonnant, des entreprises non pas de divertissement mais de communication, telles le quotidien Libération dont les titres, et parfois la “une” (infra) sont systématiquement arrangés pour faire un écho sonore à peu de frais (Compost mortem annonce ainsi un article sur le 1er novembre et les techniques funéraires ; Jeux de demain, un article sur les consoles et manettes de jeux vidéos, etc.). Le caractère systématique de cette présentation de l’information a vraisemblablement une fonction de mise à distance ou de déréalisation qui spécifie l’info 68 dans la presse sérieuse.

Les héritiers de Brisset, eux, se reconnaîtraient davantage parmi les disciples de Jacques Lacan (1901-1981), psychanalyste français dont la parole prophétique a convaincu la fleur d’une génération de chercheurs en sciences humaines, éblouis par “cet art très sublime de se passer d’instruction et de suppléer aux sciences par les calembours” et “payant tribut” à la “frivolité”, que le calembour ou l’analogie pouvaient tenir lieu de concept et, sinon montrer “le chemin de l'arbre de vie” (Brisset), du moins illustrer – l’“affaire Sokal” en a fait la salubre et irréfutable démonstration – l’art de se payer de mots et de vendre des vessies pour des lanternes. (Symptôme de cette contagion : le directeur d’un prestigieux établissement universitaire parisien – bien enraciné dans l'institution, par le fait – pouvait ainsi accrocher dans son bureau de fonction un montage artistique représentant cette pensée lacanienne : “Les noms dupes errent”, manière d’afficher, avec un clin d’œil complice, cette distance amusée qui sied à l’intello à qui on ne la fait pas – mais qui ne voudrait surtout pas avoir l’air d’être dépassé par la mode.) La reconnaissance de la polysémie prouve, quoi qu’il en soit, l’appartenance de l’amateur de calembour à la famille humaine. Ce qui a fait dire à un grave philosophe que “le calembour [était] la forme la plus basse du sentiment des sonorités verbales : voilà pourquoi il lui arrive de rapprocher les grands artistes et les grands imbéciles”.
Le trait d’esprit
Le trait d’esprit (l’esprit ajoutant la réflexion à la réverbération) se signale par une double ligne significative : ce n’est pas seulement le bruit des mots qui interfère (lourdement) dans le sens construit par le déroulement de la phrase, c’est, cette fois, un autre sens qui redouble ou contredit le premier. Ainsi la duplicité du “le” dans l’exemple de Molière, cité par Bièvre, qui représente à la fois Tartuffe (l’œuvre) et Tartuffe (le président de Harlai). Willy, mari abusif de la géniale Colette, mais tout à fait conscient des limites de sa propre inspiration, nous délivre cet avertissement d’un réalisme dégrisant : Il ne faut pas poëter plus haut que son luth ! Quand l’armée de Bonaparte a envahi l’Italie, les italiens commentaient : Tous les français ne sont pas des voleurs, ma… Buonaparte. Un ministre espagnol ayant eu l’idée saugrenue d’obliger tous les fonctionnaires à pointer à neuf heures s’est aussitôt vu qualifier d’abominable... hombre de las nieve : l’amphibologie permettant ici de moquer à la fois la proverbiale insouciance des espagnols et la consciencieuse irresponsabilité des fonctionnaires. Don't kill your wife at work. Let electricity do it…
Si homo ridens tire un bénéfice cognitif de la reconnaissance de la polysémie, c’est évidemmment le bénéfice moral, l'effet de vérité de cette dégringolade (dans l’histoire drôle) de la protase à l’apodose qui saute yeux. La morale de l'histoire de la fermeture éclair pourrait se dire ainsi (objectivement) : "La pauvre, je la plains. Comme elle se monte le bobichon avec son petit oiseau qui fait zip !" ; (subjectivement) : je me repais de sa sottise et j'engramme la (triste ?) vérité par le rire (sardonique, en l'espèce)... En effet : dans le monde sans pitié du réel que je suis payé pour connaître, ayant, comme l'abeille contre la vitre, buté contre cette nécessité que l'ivresse et l'anesthésie du jeu et du rire m'ont permis d'explorer et quitté la bulle de l'enfance pour habiter le monde des grands, je peux formuler une manière de loi de Zipf (une loi de zip, peut-être ? propre à déziper les vessies) de l'ordre des valeurs en vertu de laquelle la consistance d'un idéal a toute chance d'être inversement proportionnelle à sa distance à la nécessité biologique qu’il entend transcender. Hyperbole descendante (cf. l’opposition structurale visée plus haut) qui rappelle la colombe kantienne, ou l'oie blanche, à la réalité et me protège de telles illusions.
Soit ce mot dû à un humoriste nord-américain : La forme même des pyramides démontre - nous sommes dans le monde de la géométrie et de l’idéalité mathématique, à mille lieues de la contingence qui gouverne nos petits intérêts - du “monde de la génération et de la corruption” pour parler comme les Grecs - , il convient donc de prendre un ton quelque peu doctoral pour se mettre à la hauteur du propos. La forme même des pyramides démontre que, dès la plus haute antiquité - cette dernière proposition nous confirme dans l’intention d’édification de la sentence : du haut des ces pyramides quarante siècles nous contemplent. La forme même des pyramides démontre que, dès la plus haute Antiquité, les ouvriers avaient tendance à en faire de moins en moins. L’effet de cette rencontre entre le silence des sphères, l’éternité des formes, la profondeur immémoriale des civilisations et… le courrier des lecteurs du Figaro dépend évidemment de la position de l’auditeur dans la pyramide sociale. Racontée à la fin d’une réunion syndicale, cette histoire a peu de chances de déclencher une franche hilarité.
L’humour
L’humour aussi joue sur deux tableaux, mais dans un propos de surdétermination (telle cette inversion de l’inversion : Le masochiste : Fais-moi mal ! Le sadique : - Non !) ou d’insécurité sémantique qui effectue une mise à distance du réel. Quand un pauvre mange un poulet, dit un proverbe yiddish, l’un des deux est malade. Entre un crève-la-faim pas trop mal portant, un malheureux pauvre condamné à manger un poulet malade pour ne pas tout perdre de son capital (avec le risque de s’empoisonner pour limiter les dégâts) et un pauvre malade condamné à tordre le cou à sa plus belle volaille, à manger son capital pour survivre, il reste peu d’espace pour un bonheur vraiment sans mélange. Mais l’euphorie de cette raillerie, la célébration de cette arithmétique du malheur dont le solde est toujours négatif, pose le railleur sur un pied d’insensibilité qui constitue le bénéfice objectif de l’humour. Dans l’économie de la pénurie, “rien” n’est pas égal à “rien”, comme le montre cette histoire entendue en Pologne, avant la chute du Mur. C’est un polonais qui a besoin de chaussures et qui se rend dans un magasin d’État pour en faire l’acquisition. Les magasins d’État, c’est bien connu, sont vastes, mais ils sont vides. Notre homme se rend à l’étage où, se persuade-t-il, il a peut-être quelque chance de trouver des chaussures. L’étage est vide, en effet, il n’y a pas de chaussures à vendre. Il avise le vendeur (s’il n'y a rien à vendre, il y a bien sûr, néanmoins, un vendeur) : – Excusez-moi ! C’est ici l'étage où il n’y a pas de chaussures ? – Ah non ! ici, c’est l’étage où il n’y a pas de meubles. L’étage où il n’y a pas de chaussures, c’est au-dessus ! Cette dénégation religieuse du réel qui constituait un pilier du socialisme scientifique trouve ici un plaisant accommodement. Floué, le consommateur raille et met à distance, entre autres afflictions, celle de l’arithmétique officielle du paradis socialiste : “rien” ajouté à “rien”, cela fait pourtant un bilan “globalement positif”. Quelle différence y a-t-il, demandait-on sur la côte Ouest avant la pandémie du sida, entre l'amour et l’herpès ? Réponse : l’herpès, c’est pour toujours… On voudrait que l’amour, ce soleil de nos vies, ne s’éteigne jamais : manque de chance, ce sont les bourgeonnements post-opératoires qui sont immortels. Dans cette remarque (déjà citée) d’un (authentique) surréaliste belge : La question de l’existence de Dieu est un problème qui ne regarde que lui, ou dans les propositions du type : La vie est une maladie sexuellement transmissible, L’amour est biodégradable, etc., l’amphibologie, entretenue entre des registres opposés, Dieu/homme, vie/maladie, félicité/corruption, permet de goûter l’amère supériorité de l’humaine condition : en rire.
D’une manière générale, la rencontre des deux lignes sémantiques permet de délivrer un message surmultiplié. - Oui, d’accord, j’applaudis. Mais d’une seule main ! signifie évidemment, en ayant l'air de dire que je n'applaudis qu'à moitié, que je n’applaudis pas du tout. - Je ne serre pas la main à quelqu’un qui vient de se faire graisser la patte ! notifie publiquement la moralité douteuse de la main en question. Etc.
La rupture significative, la peau de banane sémantique cause, avec plus ou moins d’intensité, ce moment de stupeur, d’incompréhension dont joue celui qui décoche le trait. En famillle, au restaurant : Donc, dit le serveur, le papa prendra du foie [c'était avant la “vache folle” – le foie n'étant d'ailleurs pas considéré comme un MRS (matériel à risques spécifiés), merci !]. Et pour la petite demoiselle ? - ... Je vais prendre du ventre. Le papa reste interloqué : de la joue (de lotte), de la paume (d’ours) ou de la panse (de brebis farcie), oui ! mais du ventre ? !…
... /...
|