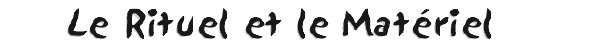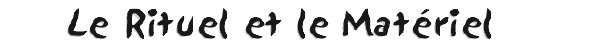|
III - 8.5 Malaise civilisateur, aise de l’homme sauvage :
la subjectivité de l’homme objectif
Le moderne peut être représenté dans sa forteresse (tout idéale), son identité circonscrite dans sa volonté, alors que l’homme traditionnel est physiquement et psychiquement dépendant d’énergies sises hors de lui et auxquelles il ne peut se soustraire sans perdre son intimité. Chaque arbre est un temple ; chaque souffle est une âme. L’intention d’autrui, la réalité d’esprits, le sens des formes constituent en même temps le for intérieur et le for extérieur de ses délibérations. Il est d’autant plus puissant et d’autant plus vulnérable que, tirant sa cohérence de la mise en communication de ces forces et de ces signes, il ne s’appartient pas. La constitution du moderne, à l’opposé, enfermé dans une subjectivité définie par son pouvoir d’objectivité, c’est la constitution de la matière. L’action magique est ressemblance, participation. Elle est sans objet et sans effet dans le désenchantement du monde et de la société. L’insécurité du monde magique a pour contrepartie la sécurité d’un monde en relation. Où l’homme se repose dangereusement de sa forme dans la forme des choses. Les adeptes des messes noires assurent trouver dans le frisson de la profanation une certitude existentielle qu’une religion convertie à la raison ne délivre plus. Le mal moderne de la solitude - mal honteux puisqu’il dénonce un échec adaptatif - les maladies de la liberté, la mode des thérapies corporelles et des thérapies de groupe dénoncent le retrait des formations collectives, où s’élabore la fermeture individuelle, comme la cause du malaise civilisateur. C’est dans cette déshérence répondant à l’idéal qui récuse la vérité spécifique (l’inflexion du corps, de la subjectivité, du temps, de la différence des sexes, de la métaphore) que s’installe le malaise juvénile. La jeunesse, main invisible de l’échange des valeurs adopte, ou croit adopter, révélés par les traditions exotiques accommodées dans les faubourgs des métropoles coloniales ou esclavagistes, les secrets perdus par la civilisation. Alors que le polytechnicien doit aller prendre des cours de danse chez “Georges et Rosy” (quand Polytechnique était au Quartier Latin) pour être en mesure de tenir sa partie au bal de fin d’année, le primitif aurait “dans le sang” ou “dans la peau” un savoir de la nature dont le défaut, la récusation ou la réfutation caractérise l’éducation moderne. Il est significatif que le stigmate d’animalité, qui constituait hier l’argument majeur du racisme, puisse être aujourd’hui un signe d’élection : “[Il] donne en plus une leçon, et c’est qu’un noir peut imiter un blanc et non l’inverse. Car la culture occidentale s’apprend alors que l’animalité africaine est innée. Cette supériorité est spécialement manifeste dans “Say, say, say”, la chanson qu’il interprète aux côtés de Paul McCartney. Non seulement il chante aussi bien que son partenaire, mais il possède en plus une certaine sauvagerie dont Paul McCartney, lui, est démuni” (France-Soir Magazine du 21 avril 1984). On mesure l’évolution par rapport à la génération précédente où l’adoration de “Sa majesté le Jazz” était tempérée par la critique de jazz, cette spécialité blanche qui légitime et convertit l’interprète en mettant du sens dans son naturel : et “si les Blancs finalement”, interroge une signature autorisée épinglant les “effarantes faiblesses” de Mo’ Better Blues, film du réalisateur noir Spike Lee (“Il y a autant de Blancs dans mes films qu’il y a de Noirs dans les films de Woody Allen”) ayant le génie du jazz et son exploitation commerciale pour sujet, “avaient le talent de parler du jazz ?” (Le Monde du 22 novembre 1992).
... /...
|