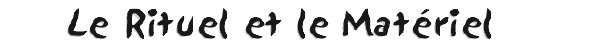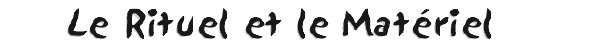|
I - 2.06 Thésée, chef d’initiation ?
Le destin de la tête, pour traduire librement le titre de Frobenius dont est extrait le dialogue, rapporté plus haut, est-il l’oblation ? Le destin de Thésée est-il de cet ordre ?
“Engendré à la dérobée et supposé né de la semence d’un dieu”. Ainsi Amyot, traduisant Plutarque, définit-il la naissance du héros. Égée, roi d’Athènes, n’avait pas d’enfant. Il part consulter l’oracle de Delphes. Ayant reçu une réponse énigmatique, il se rend à Trézène ou règne le sage Pitthée, fils de Pélops, afin de lui demander conseil. L’oracle, qui défend à Égée d’approcher aucune femme avant son retour à Athènes, aurait annoncé en termes enveloppés (“Ne pas délier le pied de l’outre”) la gloire de l’enfant né d’une telle union et c’est pour cette raison que Pitthée, faisant boire Égée et l’enivrant, s’arrangea pour qu’il ait commerce avec sa fille, Aethra. Mais, la même nuit, Aethra est aimée de Poséidon... Thésée naît donc à Trézène où il est élevé par son grand-père maternel. Ayant appris le nom de son père, il se rend à Athènes après avoir pacifié le pays. Égée le reconnaît grâce aux signes laissés à Aethra et le déclare publiquement pour son héritier.
Comment Thésée va-t-il œuvrer pour rétablir le trône et mettre fin à une situation de chaos engendrée par l’incapacité d’un père à assurer la succession ? Thésée trouve en effet l’État troublé par les dissensions politiques et les affaires privées d’Égée : guerre civile fomentée par les cinquante fils de Pallas, frère puîné d’Égée - quand lui-même est sans héritier - gouvernement féminin : c’est Médée qui règne, ayant promis une descendance au vieux roi. La réponse à cette question - l’exploit de Thésée - renferme, par hypothèse, le principe de régénération et de restauration ici exposé.
“Cependant, raconte Plutarque, quand l’échéance du troisième tribut fut arrivée, et que les pères qui avaient des enfants encore jeunes durent les présenter pour le tirage au sort, il y eut contre Égée une recrudescence de plaintes de la part de ses sujets : ils gémissaient et s’indignaient de voir qu’Égée, l’auteur de tout le mal, était le seul à ne prendre aucune part au châtiment et qu’après avoir réservé le pouvoir à un fils bâtard et étranger, il n’avait cure de les voir privés de leurs enfants légitimes et laissés sans descendance. Touché de ces plaintes, Thésée pensa qu’il était juste de ne pas les négliger et de partager le sort de ses concitoyens. Aussi s’offrit-il volontairement sans participer au tirage au sort. Tous les Athéniens trouvèrent cette grandeur d’âme admirable et furent charmés de son dévouement au peuple, sauf Égée. Celui-ci eut beau le prier et le supplier : il le trouva inflexible et inébranlable. Alors il procéda au tirage au sort des autres enfants. [...] Auparavant, comme on ne concevait aucun espoir de salut, le vaisseau qu’on envoyait portait une voile noire en signe de malheur certain. Mais, cette fois, comme Thésée rassurait son père et se faisait fort de maîtriser le Minotaure, Égée donna au pilote une autre voile, une blanche (ou pourpre) avec ordre la hisser au retour, si Thésée était sauf ; sinon de naviguer avec la noire pour annoncer le désastre.[...]
Quand Thésée eut abordé en Crète, suivant la plupart des récits en prose et en vers, il reçut d’Ariane, qui s’était éprise de lui, la fameuse pelote de fil et il apprit d’elle les moyens de venir à bout des détours du Labyrinthe ; il tua le Minotaure et remit à la voile, en emmenant Ariane et les jeunes gens.” (Vie de Thésée, 17-19)
Le parallélisme, dont nous avons fait mention de manière conjecturale, entre l’expulsion du pharmakós, ou des pharmakoí, le 6 de Thargélion et le départ des jeunes gens livrés en tribut (le 6 de Munichion), c’est-à-dire la mise en abîme du rite annuel et du rite novénaire (selon la manière grecque de compter : le “un” est un prédicat d’existence et non une quantité ; c’est le pythagoricien Archytas de Tarente qui invente le nombre un) pourrait servir de prémisse pour tenter de rapprocher théorie du pharmakós, théorie de l’initiation et théorie de la souveraineté. Le propos sera ici, plus restrictivement, de servir l’“énigme” que constitue la connexion, entre l’avènement d’une nouvelle classe d’âge et le régicide, cette “curieuse relation” dont Frobenius est l’inventeur et dont Jeanmaire a montré la réalité “archéologique” dans la geste de Thésée.
Parmi d’autres valeurs, le motif initiatique apparaît dans plusieurs séquences de l’expédition que Thésée conduit en Crète, assurant le retour victorieux du tribut en jeunes gens livré au Minotaure. L’initiation met en scène un monstre dévoreur d’adolescents et met en vedette un chef initiatique, un modèle ; elle se développe aux marches du royaume et en marge de l’espace politique dans un temps hors temps qui est souvent celui de l’interrègne ; elle concerne les jeunes gens en âge critique et a pour objet la différenciation sexuelle ; elle touche au mariage et à la fécondité des humains ; elle se révèle indispensable à la reproduction de la nature.
L’expédition de Thésée peut s’analyser comme le développement d’un modèle matrimonial libéré ou produit par la définition des genres en quoi consiste l’initiation. “L’entreprise de Thésée, notait Jeanmaire (1939 : 323), inaugurée sous le patronage d’Artémis et continuée sous celui d’Aphrodite se termine sous celui d’Ariane-Aphrodite.” On peut remarquer de prime abord qu’en gagnant Ariane aux Jeux organisés par Minos, Thésée donne une définition vraie du “beau-frère”. En “ôtant l’honneur au capitaine Tauros”, selon l’expression d’Amyot - dans les règles -, il libère la cité d’un tribut imposé en réparation de l’assassinat d’Androgée venu combattre aux Jeux athéniens. Il transforme le beau-frère monstrueux et le beau-père vengeur en partenaires d’alliance. Une tradition dit que Minos ne se contenta pas de remettre le tribut, mais qu’il donna de plein gré Ariane en mariage à Thésée qui l’avait débarrassé d’un général encombrant. La paix scellée par mariage sert autant Thésée que Minos. Thésée annule la faute d’Égée et ses conséquences en s’offrant au monstre et en s’opposant à lui. Selon des valeurs plus générales, ou plus élémentaires, dans les initiations, ce que le néophyte doit vaincre, c’est un monstre : c’est une construction mythique, c’est sa peur (Thésée vainc les amazones après avoir offert un sacrifice à la Peur - Vie de Thésée, 27, 2), c’est lui-même. Pour naître en tant que masculin, il lui faut s’arracher à la protection maternelle. C’est ce travail ontogénétique de changement de sexe que paraissent dramatiser les rites en cause. Le combat contre un monstre masculin prend fond sur une représentation étouffante de la féminité : Thésée vainc le Minotaure dans le ventre labyrinthique (le labyrinthe étant aussi la figure de l’expédition sans retour et de la descente aux Enfers). L’homme repose dans la tension qui l’oppose à d’autres hommes, tension qui implique en premier lieu la mort initiatique ou la mort du “féminin” en lui. Le motif du changement de sexe est explicite dans de nombreux mythes et rites initiatiques. Ainsi, par exemple, le cycle du Petit Poucet comporte-t-il, comme le note Jeanmaire, un épisode dans lequel le héros et ses frères échappent aux dents de l’ogre en changeant de sexe par l’échange de leurs vêtements avec ceux des petites ogresses. La fonction de l’ogre (du “crocodile”, du circonciseur), c’est de dévorer la fille (ou de trancher le prépuce). Donner le change à l’ogre, c’est savoir se dépouiller de cette féminité qu’il a charge de dévorer. C’est renaître.
Jeanmaire a reconnu ce thème du travestissement et du changement de sexe dans deux épisodes de la geste de Thésée. Plutarque explique ainsi le travestissement des Oschophories : “Thésée n’avait pas emmené en Crète toutes les jeunes filles désignées par le sort ; il prit avec lui, pour compléter le nombre, deux jeunes gens qui vivaient dans son intimité. Ceux-là étaient d’apparence féminine et délicate, mais d’âme virile et résolue. Il leur donna des bains chauds, les fit rester à l’ombre, prodigua les onguents et les soins de toilette à leur chevelure, à leur peau, à leur teint qu’il transforma dans la mesure du possible. Il leur apprit à imiter de leur mieux la voix, les allures et la démarche des jeunes filles, de sorte qu’à l’extérieur, ils ne différaient en rien d’elles. Il put ainsi les glisser parmi les partants sans que nul s’en aperçut. À son retour, il alla en procession avec les jeunes gens, habillés comme le sont maintenant ceux qui portent les branches de vigne” (Vie de Thésée, 23, 3 et s.). “On dit que le dieu de Delphes prescrivit à Thésée de faire d’Aphrodite son guide et de l’invoquer comme compagne de voyage. Il offrit donc un sacrifice à cette déesse sur le bord de la mer et la chèvre qu’il immolait se changea miraculeusement en bouc. En conséquence, Aphrodite reçut le nom d’Epitragia” (Ibid. : 18, 3). Miracle du rite qui réalise, avant le drame, l’intention de l’action et qui résout la crise de l’ambiguïté sexuelle par la pédagogie de la mise en scène.
... /...
|
|