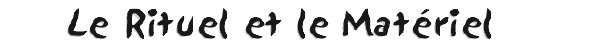|
|
Les facteurs culturels du développement
Introduction
pour un projet de recherche partagée dans le sud-ouest de l’Océan Indien :
Réunion, Maurice, Comores
Comparaison n’est pas raison. Sans doute. Mais, au-delà de cette évidence, quand les termes à comparer sont suffisamment proches - unité géographique, histoire en partie commune, parenté dans la généalogie du peuplement - et que les situations finales, malgré ces similitudes organiques, sont diverses, voire contraires, on peut tirer raison de la comparaison. Davantage : en permettant d’évaluer la part relative des différents paramètres dans ces situations, la comparaison permet de réaliser une “expérimentation” - au sens où l’on peut parler d’expérience en astronomie : l’observateur ne commandant évidemment pas le déroulement de l’expérience - de porter un diagnostic et, on peut l’espérer, de mieux adapter les actions.
Le projet ici présenté réunit donc, à Maurice, à la Réunion et aux Comores, des enseignants et des chercheurs (linguistes, sociologues, anthropologues, historiens, économistes) qui ont décidé d’associer leurs disciplines et leur expérience dans cette cause commune.
*
On partira des situations existantes pour remonter aux facteurs supposés expliquer les différences et les similitudes. L’histoire, la religion, la culture, la famille, l’éducation seront convoqués dans un premier examen critique à l’occasion d’une première rencontre, qui devrait se tenir à l’université de la Réunion, où seront définis les méthodes, les concepts et les champs de l’analyse, où seront réparties les tâches respectives et confirmées les échéances.
I - Le développement, pourquoi ? Le développement, pour quoi faire ?
On s’interrogera d’abord, et ce avec d’autant plus de raison que le développement n’est ni une évidence ni une nécessité pour tous, sur les circonstances historiques et culturelles qui, en Occident, ont “inventé” l’économie - quand, auparavant et partout ailleurs, l’économique, loin de se subordonner le social, lui est soumis. L’économie politique devra donc constamment être mesurée à l’anthropologie sociale et à l’histoire culturelle. La “richesse des nations”, qui résulte de la multiplication des actes économiques en fonction de la multiplication des échanges, suppose l’activité de catégories mentales et de valeurs rien moins qu’universelles. Que peut signifier le développement, par exemple, dans une culture dont la langue ignore le temps du futur (sauf immédiat, comme nombre de langues traditionnelles et le créole, par exemple), où la nouveauté, loin de constituer l’argument publicitaire par excellence, est le plus sûr indice de l’absence de valeur? Ce n’est pas dire que la société traditionnelle n’évolue pas, mais constater que son idéologie a pour idéal la neutralisation du changement. C’est aussi constater que l’espoir terrestre, le risque calculé, l’inquiétude vitale - “uneasiness” est ce mot singulier qui inaugure la philosophie de l’empiriste Locke, le père de la constitution anglaise - sont au coeur de l’industrie : de l’activité industrieuse qui a le développement pour conséquence.
II - L’intelligence des fourmis.
De préférence à l’explication énigmatique de la “main invisible”, on pourra se tourner, pour rendre compte du résultat surprenant, en effet, de cette cumulation d’actes dont procède la “richesse des nations”, vers des modèles aujourd’hui explorés en intelligence artificielle, où l’absence d’unité centrale autorise pourtant, comme dans les sociétés de fourmis, l’édification d’organisations élaborées et hiérarchisées, sommation d’opérations parcellaires “aveugles”. Adam Smith, d’ailleurs, reconnaissait sa dette à l’égard de la fable des abeilles de Mandeville. Il s’agit, en réalité, à partir de cette image paradoxale, de comprendre la genèse d’un environnement socio-culturel où la poursuite d’intérêts individuels concurrents engendre la division du travail et la spécialisation sociale, telles qu’on peut les observer dans les sociétés dites complexes où la distribution et l’action des hommes paraissent obéir à des nécessités qui les dépassent. Le développement résulte-t-il nécessairement, d’ailleurs, de cette culture de l’individualisme qui, en Occident, l’a engendré ? Les économies asiatiques ne démontrent-elles pas aujourd’hui, ses acteurs étant davantage imprégnés de culture bouddhique que de religion individuelle, les limites d’un tel aiguillon ? Dans les sociétés considérées et en gardant à l’esprit ces données générales et programmatiques, on se donnera pour objet, à partir d’observations concrètes, de données statistiques et d’analyses sociologiques, de repérer les éléments facilitant et les blocages. De restituer de l’intérieur les stratégies individuelles sans la connaissance desquelles l’action est impropre.
III - Croquis sur le vif.
Ainsi qu’il a été noté en préambule, la comparaison - alors que le fait de rester immergé dans un seul milieu pétrifie l’observateur : interdit l’observation - peut provoquer un déclic analytique salutaire. Un voyageur curieux qui relierait ainsi successivement Saint-Denis, Moroni et Port-Louis serait en mesure, sans doute de manière superficielle, mais non dénuée de sens si les cultures se spécifient aussi dans la façon dont elles agencent les données élémentaires de la quotidienneté, de repérer quelques éléments diacritiques pouvant donner lieu à une analyse plus approfondie.
Venant de Saint-Denis, déserte à partir dix-huit heures et rythmée par des horaires de fonctionnaires, le voyageur, arrivé la nuit tombée à Moroni est immédiatement surpris par l’activité nocturne - à l’africaine - de la population : mais sur quel continent la Réunion - que l’O.U.A. fit sienne quand s’est posée la question de l’indépendance - se trouve-t-elle donc ? d’où lui vient cette philosophie du temps et de l’espace privé ? (Il lui aurait été répondu, à la Réunion : “C’est la <mentalité>”) Sur le chemin conduisant de l’aéroport à l’hôtel, les villageois palabrent sur le pas de leur porte, maisons ouvertes sur la rue. Une multitude de marchands, leur étal éclairé à la lampe à pétrole, proposent savon, cigarettes, sucre et lait en poudre. Leur fonds de commerce tient dans une boite en carton qu’on transporte sur la tête. Il constatera, le lendemain matin, la multiplicité des taxis collectifs et la modicité du prix de la course : avec le prix moyen d’une course à Saint-Denis, il est possible de faire vingt-cinq à trente courses à Moroni. Il y a pénurie de farine, mais les marchés vivriers sont achalandés. La production maraîchère est vendue sans intermédiaire. Quantité de commerces de détail. Une mosquée de quartier tous les trois cents mètres dans les rues principales. La mosquée du vendredi est trop exiguë pour contenir les fidèles. Le pèlerinage économique dans les pays du Golfe fait circuler des marchandises venues d’ailleurs. Zanzibar en constitue le relais. La bière et les sodas viennent d’Afrique du Sud ; une marque de boisson est fabriquée localement. Le commerce de gros est tenu par quelques notables (en tractations, d’ailleurs, avec l’Etat fédéral à propos de la dévaluation du franc C.F.A. et ayant fermé leurs magasins) dont un Indien. L’hôtelier - d’origine indienne et venu de la Réunion - commente à l’intention du voyageur (il lui confiera le chèque que celui-ci lui remettra en paiement afin qu’il le dépose sur une banque réunionnaise) : “Ici, il n’y a rien a acheter, mais on a la tranquillité. A Saint-Denis, vous voulez du fromage ? Vous avez trente sortes de fromages ! Vous voulez de la confiture ? Vous avez au moins dix sortes de confitures ! Ici, vous revenez du marché avec des choses que vous n’aviez même pas l’intention d’acheter, faute d’avoir trouvé ce que vous cherchiez ! Mais au moins, on a la tranquillité.” Le tourisme est peu présent. Dans le nord de la Grande-Comore, un hôtel sud-africain, qui a passé un contrat léonin avec l’Etat fédéral, accueille les touristes de lointaines croisières et des charters venus d’Allemagne. Une seule nuitée coûte plusieurs fois le salaire mensuel d’un fonctionnaire. Sur un site touristique proche, des enfants proposent à la vente, en anglais, librement exposés sur une natte, des coquillages dont le commerce est interdit. L’Etat est peu présent. Des voitures circulent sans plaque d’immatriculation. Ayant fait le tour de l’île dans un véhicule que les gamins auront pris pour un véhicule militaire, le voyageur se fera apostropher par des : “Manger ! Dormir !”, deux activités qui symbolisent, aux yeux des Comoriens, l’action d’une armée qui avait disparu quand les mercenaires de Bob Dénard ont pris possession de l’île. Le sable des plages est en vente au bord des routes. La quantité de maisons individuelles en construction lui sera expliquée par l’argent des émigrés qui rentrent au pays, ou en vacances, tels des notables en puissance et qui sont, en effet, en mesure de célébrer le dispendieux et prestigieux “grand mariage”, celui qui permet à un homme d’accéder à la classe des “grands”. Mais aussi par la coutume locale qui impose à l’homme, dépendant de son matriclan et venu s’installer dans le village de son épouse, de construire une maison pour sa fille quand elle sera en âge de s’établir. Le sable des plages, en vente au bord des routes, passe sans reste dans la construction de ces caisses d’épargne à ciel ouvert. Dans un village côtier, où la plage n’a pas disparu, un religieux en a interdit l’accès aux Comoriens. Celle-ci est abandonnée aux moeurs futiles et dégradantes des infidèles et des coopérants. Dans les villages, les écoles sont délabrées et les mosquées, qui appartiennent aux villageois, jalousement entretenues. L’enseignement public n’est plus assuré. L’intégrisme est en passe d’absorber l’islam ouvert et tolérant (originellement shirazien d’ailleurs, comme en témoigne la “mosquée mystérieuse”, dont la légende dit que ses bâtisseurs l’ont trouvée tout achevée un matin - et qui, aujourd’hui battue par les flots d’une mer qui gagne sur le rivage, risque d’avoir disparu un matin) où s’exprimait l’identité comorienne.
A Port-Louis, autre choc culturel. Installé dans le quartier des entrepôts, le voyageur est saisi par l’activité économique - à l’asiatique - de ce quartier à la fois chinois, indo-musulman, hindou ; pris à la gorge, peut-être, par l’odeur âcre du poisson séché, et capiteuse des épices indiennes. Arrivé pour le Cavadee, jour férié en raison de cette manifestation religieuse, dans cette procession “d’un autre âge” traversant, dans Royal street, le quartier des affaires - buildings modernes jouxtant les vieux entrepôts promis à démolition et procédant l’un de l’autre comme la banque et les services de plusieurs générations de négoce - il aura le spectacle paradoxal de la collaboration, ou de la coexistence, de la ferveur religieuse et de la fièvre économique. Sur le bitume arrosé par les moto-pompes de la ville qui les précèdent, les pénitents, ayant parcouru plusieurs kilomètres, pliant sous le poids du cavadee parfois soutenu par quelques familiers (le feuillage, cueilli la veille, déjà flétri par l’ardeur du soleil), les joues transpercées, quelquefois la langue, le dos fiché de lancettes ou piqué d’épingles où sont accrochés des citrons verts, composent, dans la réunion de leur corps et du cavadee, la syllabe sacrée OM : le sens de notre vie commence bien loin au-delà de nous. Ce sens, que la modernité occidentale récuse, est pourtant ici porteur, entre artha (intérêt), dharma (loi) et karma (destin), pour sa part - et l’objet de la recherche est de tenter de déterminer comment - du miracle mauricien. Du premier étage de leur boutique-entrepôt où ils habitent, des commerçants chinois regardent distraitement la procession. Quelques boutiques sont d’ailleurs ouvertes. Dans une rue adjacente, un marchand ambulant vend soupe et bol de nouilles que l’on consomme sur le trottoir, assis sur un banc adossé au mur. Chose presque incroyable, aujourd’hui, à la Réunion : un Chinois vend des poules enfermées dans de rudimentaires cages en cerceaux. La fête terminée, le Président ayant honoré le temple de sa visite, les cavadee rentrent en Mitsubishi, faisant tinter les clochettes. Une question viendra peut-être à l’esprit du voyageur : “Mais où sont les Créoles ?” Une affiche interroge, en effet, caractères noirs sur fond rouge : “Quel avenir pour la communauté créole ?” annonçant une manifestation pour le 1er février. Le Créole serait donc le grand absent du développement mauricien. Dans cette société structurée par les préséances ethniques et un exclusivisme religieusement entretenu, où le communalisme, que chacun pratique, est officiellement traqué, le Code Napoléon - qui fait précisément silence sur la question religieuse - et l’affairisme constituent le commun dénominateur de la réussite. Et si le “malaise créole” révélait la “question sociale?
A Saint-Denis, les voitures postales sont jaunes, comme en métropole, les autobus comme à Paris et l’infrastructure routière, panneaux de signalisation compris, à l’identique (alors qu’à Port-Louis, les autobus sont indiens, de marque Tata, japonais - et passablement usagés). L’importance et la jeunesse du parc automobile sautent aux yeux (quand circulent à Port-Louis nombre de vieilles Morris qu’on ne trouve plus que dans les musées). Près de trois ménages sur quatre possèdent un véhicule, souvent deux, et 59% du parc a moins de cinq ans, contre 44 en métropole ! Le “4 X 4” - le casque colonial pour tous et les grands espaces pour les employés de bureau - paraît être un indice de promotion créole. Les embarras de la circulation ne sont pas moins spectaculaires. Dans un courrier des lecteurs, sous un : “Quand la route s’éveillera !”, la présidente d’une association d’usagers explique que la “poudrière” de la Réunion, ce ne sont pas “nos chômeurs et nos jeunes désoeuvrés”, “l’explosion sociale (n’ayant) pas lieu, parce que le R.M.I. est là... avec un peu de travail au noir”, mais les automobilistes : “Celui qui entre dans les embouteillages à 6 heures le matin et en sort à 19 heures voire 20 heures le soir finit par se trouver aux portes de la folie douce.” “Il ne faudrait pas que cette folie devienne furieuse.” Et d’évoquer, pour porter remède à cette servitude, des “boulevards Sud, Nord et Est - promis par les élus - en attendant la lune”. L’I.N.S.E.E. estime à 110.000 le nombre de véhicules supplémentaires en l’an 2000. Personne n’est en mesure de dire où ces véhicules pourront circuler. Autre signe éclatant de la prospérité urbaine : l’importance et la quantité des supermarchés. En dix ans, la Réunion a atteint le taux d’équipement en hypermarchés (superficie supérieure à 2.500 mètres carrés) que la métropole a mis trente ans à atteindre (soit 158 mètres carrés de grandes surfaces pour 1.000 habitants). L’année 1993 aura été celle de l’arrivée dans l’île des marques “hard discount” de la grande distribution. Notre voyageur se sera fait un devoir de traverser le Chaudron, haut lieu des émeutes de 1991. Il aura appris que la raison n’en était pas le quartier - rien à voir avec Gennevilliers ou les Minguettes - mais la saisie d’une télévision pirate au beau nom de Free Dom qui a introduit dans les foyers le film pornographique, la violence crue et la “télédoléance”, soit l’invitation faite aux téléspectateurs de dire leur sentiment, enchaînée de : “Merci de votre opinion !” - ce cocktail constituant, en effet, un mélange détonnant dans une société ou le clientélisme politique, par le biais de l’emploi communal notamment (les communes sont le premier employeur de l’île) a reconduit à sa manière, sous une autre chape, les valeurs du paternalisme colonial et de l’organisation servile. Tous les professionnels de la politique ont bien entendu été pris de court par les succès électoraux de Free Dom, succès administrant la preuve de l’indifférence des électeurs à la politique. Chez les marchands de journaux, il sera probablement étonné par l’assortiment des revues dites “de charme” (à caractère pornographique, en réalité), en troisième position des ventes, et des revues de muscle. La fonte et le matériel adéquat, dont l’efficacité est régulièrement vantée dans la presse quotidienne, sont d’ailleurs en vente dans les supermarchés. A la Réunion, “les filles sont 'canon'”, selon le rédacteur en chef d’une revue de charme locale (soft), mais “les Réunionnais sont tristes”, selon la présidente du Conseil Régional. Dans les librairies, le rayon occultisme est de loin le plus fourni (si l’on excepte la librairie scolaire) et le marché de la magie prospère, comme en témoigne l’abondance des annonces de marabouts africains venus de la banlieue parisienne. Une bonne douzaine d’hommes politiques sont mis en examen pour ingérence, corruption, faux en écritures, trafic d’influence. Plusieurs sont en prison. L’un d’eux en fuite. Dernière évidence du paysage réunionnais, qui tranche aussi avec Maurice et les Comores, c’est la présence, avec la départementalisation, de “métropolitains” - “de passage” et constituant, comme le souligne un politique local, la seule population non autochtone qui continue de croître alors que l’immigration est sévèrement contrôlée - dont le nombre, sans commune mesure avec celui des coopérants ailleurs et d’une tout autre nature, a en effet été multiplié par 12 ou 13 en quelque 30 ans ! De manière peut-être moins anecdotique qu’il y paraît, un effet de cette présence sur l’identité peut être illustré par la lecture des annonces gratuites d’un quotidien. A la rubrique “FEMMES”, 21 annonces sur 50 cherchent “homme métro”. Les gendarmes (“gendarmes uniquement”), les militaires et les enseignants sont particulièrement recherchés. Bien que souvent réputés souffrir d’acte bref, ils remontent ce handicap véniel par une culture des préliminaires (“métro gentil”) et du partage domestique (“métro non buveur”) qui rend d’autant plus attractif leur régularité de fonctionnaires et leur garantie de “pied de riz”. Ils occupent des positions en vue, supérieures aussi, du fait de l’indexation des salaires et de l’absence de concurrence locale, à ce qu’ils pourraient espérer en métropole. Réserve faite de la fréquentation des “filles canons” - le cliché de la fille des îles d’ailleurs rehaussé par contraste avec le féminisme métropolitain - qu’autorise leur statut économique, les “zoreils” vivent en milieu fermé, ignorants des cultures et des hommes qu’ils côtoient, dans des zones de l’île réputées autrefois inhabitables (au bord des plages, parfois en zone inondable), en lotissements dont le règlement interdit la possession de coqs. Il suffit de les observer faire leur provision de viande rouge, le samedi, dans les supermarchés de leurs ghettos balnéaires pour comprendre qu’ils appartiennent à un autre monde.
IV - Structures morales et structures économiques : éléments de comparaison.
Le programme se donnera donc pour objet la recherche des conditions, dans la représentation du monde des sociétés en cause, dans le plan de vie qu’elles assignent à leurs membres, qui rendent l’entreprise et l’innovation pensables et possibles. De leur capacité à répondre à une pression économique ou politique extérieure. Dans sa simplicité première, la question se pose ainsi : “Quand il s’éveille le matin, quelle nécessité pousse un individu à entreprendre telle action, à courir un risque, à s’engager ? Quelles considérations, à l’inverse, lui représentent la vanité, le danger, l’inutilité d’un tel investissement d’énergie? Quelles perspectives, pour lui, pour sa famille, pour le groupe auquel il appartient la décision ouvre-t-elle? “ Où, pour reprendre un exemple cité, entre artha, dharma et karma, placer l’initiative ?
Sous le titre “Age de pierre, âge d’abondance”, on a pu spectaculairement montrer que c’était par l’effet d’une obligation culturelle - ou d’une organisation socio-économique spécifique - et non par l’effet d’une nécessité naturelle, que l’homme était condamné à gagner son pain à la sueur de son front, et que les sociétés de chasseurs-cueilleurs ignoraient ce que nous dénommons “travail” - que nous parons de toutes les vertus (l’oisiveté, avons-nous appris à l’école, étant la mauvaise mère de tous les vices). La quantité d’activité nécessaire à la subsistance et à la dignité humaine est une chose toute relative. Il y a, dans la société traditionnelle, un art de ne “rien faire” qui est tout le contraire de l’inactivité. Les notables villageois comoriens qui se retrouvent, après la prière, assis en rang de préséance sur les stalles du bangwe ne sont pas les inactifs qu’il donnent à voir à un regard étranger, passant le temps en causeries et palabres. Non seulement traitent-ils, dans cette assemblée publique en forme de lit de justice, des litiges, de la gestion et des lendemains villageois, mais ils donnent à voir, comme le fait une opération à coeur ouvert, la pulsation qui donne vie au corps social. La structure même de la place du bangwe, dans sa complexité spatiale et architecturale, avec ses divisions, ses retraits, ses niveaux et sa distribution ordinale exerce une pédagogie silencieuse sur celui qui la traverse. Il y a une activité qui, pour ne pas être neg-otium (soit négation d’otium : /l/oisir) n’est pas pour autant oisiveté. Le négoce n’étant qu’une forme particulière d’activité, quand bien même elle disqualifie les autres, comme le confirme l’étymologie. Dans quelles conditions, donc, ceux qui sont sans travail sont-ils condamnés à n’être que des disoccupati (puisque c’est ainsi que sont considérés, par ceux du nord, les hommes “sans travail” du mezzogiorno) ? Quelle structure, ou absence de structure - sociale, familiale, culturelle - condamne l’individu à la tâche ou à la dégradation ? Quelles conditions peuvent expliquer qu’une population déplacée, déculturée soit du même coup privée de sa capacité de réaction ? Et qu’une autre, pourtant, fasse d’une identité préservée dans des conditions apparemment identiques l’instrument d’une reconquête ?
A - Un regard sur l’économie de Maurice à travers l’industrie du tourisme.
Maurice attend 400.000 touristes en 1994. Phénomène socio-économique récent et dont l’importance peut être mesurée par le fait que la valeur des échanges touristiques mondiaux est égale à la moitié des échanges agricoles, l’industrie du tourisme, qui déplace chaque année des millions d’hommes du nord vers les pays du sud, engage aussi des enjeux culturels et politiques dont la portée peut être résumée par la rude prédiction de Frantz Fanon qui voyait les pays du Tiers-Monde devenir les “bordels des pays développés”. Quand les poubelles du défunt Club Méditerranée de Casamance étaient militairement gardées pour dissuader la population locale de s’y approvisionner ; quand le tourisme sexuel est devenu si criant qu’on exécute, au Siam, pour se protéger du SIDA, les filles qui rentrent au village après avoir travaillé à Bangkok, on voit que cette activité, qui constitue la principale source de devises de nombreux pays sous-développés, apporte aussi des dommages considérables : de la “pollution morale” (pour reprendre une expression chinoise) à laquelle répond l’intégrisme, à la pollution écologique, dont les effets sont souvent irréversibles. Le tourisme étant sous le contrôle des pays développés, par le biais des chaînes internationales, des compagnies aériennes et des “tours opérateurs”, il peut être éclairant d’analyser la manière dont Maurice a “négocié” ces difficultés.
Bien que n’ayant visiblement pas échappé au “bétonnage” de son littoral, à la privatisation de ses plages, au “mitage” et au détournement de ses terres agricoles, à la spéculation foncière induite, à l’“invasion touristique”, avec le sentiment de dépossession et l’hostilité que de telles adultérations engendrent, et bien que l’industrie du tourisme, à Maurice comme ailleurs, soit contrôlée par les grandes chaînes hôtelières internationales, l’implication du capital local et de nombreux privés dans cette activité manifeste que les chaînes du tourisme et leurs néo-colonies de vacances, troisième source de revenus de l’île, n’entravent pas toujours et nécessairement le développement local. La question mérite évidemment une approche systématique. Une étude parallèle de la structure financière des sociétés opérant dans la zone franche, créée en 1981, montrerait d’ailleurs le rôle respectif des différentes communautés de l’île dans le développement des activités, et la transformation - confirmation du dynamisme économique et de la capacité d’adaptation de ses agents - du capital ayant le sucre, le commerce ou la distribution pour origine en capital manufacturier et en sociétés de services, de l’assurance à l’informatique, donnant à Maurice les moyens de devenir, après avoir couvert les besoins essentiels de sa population, modernisé son agriculture et conquis une toute première place dans la production textile mondiale, la métropole incontestée du capitalisme financier et de la création incorporelle dans le sud-ouest de l’Océan Indien,
B - Le déséquilibre réunionnais exprimé par la balance commerciale de l’île.
Rien ne saurait mieux exprimer le “mal réunionnais” - économique et moral - que la présentation du déficit de la balance commerciale - souvent incriminé, d’ailleurs. Équilibrée dans les années cinquante, quand la structure économique était encore celle d’une colonie d’exploitation et de peuplement, elle accuse un déséquilibre qui va s’accroissant chaque année, le taux de couverture passant au-dessous de 10% en 1988 pour ne plus représenter que 7,5% en 1993 (quand l’île exporte 7, elle importe 93).
C’est donc en exécution de la départementalisation, effective à partir des années soixante, que se met en place une économie dite “de transfert”, visant à rattraper les retards en matière d’équipement, de service public et de protection sociale de cette possession devenue département par la loi du 19 mars 1946. L’action publique vise alors à instituer une parité entre deux systèmes économiques, entre deux cultures, aux antipodes : une colonie marquée par le stigmate de l’esclavage, par l’engagisme, la diversité ethnique et le défaut d’histoire, et une démocratie parlementaire sortie d’un millénaire capétien ; une économie traditionnelle reposant sur l’auto-suffisance familiale, dépourvue de protection sociale, dépendante de la plantation, et une économie à haut niveau de développement industriel où la consommation et la protection sociale sont devenues des évidences sociologiques.
L’analyse du déséquilibre de la balance commerciale confirme ce que tous les Réunionnais savent, quel que soit le sens qu’ils lui donnent : que le déficit commercial de l’île est égal au montant des transferts résultant de la “solidarité nationale”. Comment l’homme de la rue pourrait-il ignorer que ce qui s’achète l’est aussi à ce titre ? Le caractère spectaculaire, noté plus haut, de la “société de consommation” à la Réunion, qui est, en réalité, une société de distribution, tient au fait que l’essentiel de l’activité économique visible, en effet, se résume à la distribution, c’est-à-dire à la dépense, au profit des grandes enseignes commerciales et du bâtiment, sans qu’il en résulte de véritable croissance économique, des fonds de transfert. La nature de cette économie blanche - une économie sans création économique : la Réunion n’exporte que des produits agricoles, raffinés certes (sucre, rhum, essences...) mais comme d’autres pays sous-développés, les produits à forte valeur ajoutée qui sortent sont, en réalité, des exportations d’importations transitant par un comptoir commercial - mesurée par le déficit des échanges avec tous les voisins régionaux (sauf Comores qui s’approvisionnent en produits pétroliers, tôles ondulées - ah ! le clientélisme ! - voitures particulières, équipement automobile) se résume dans la coexistence paradoxale, qui était d’ailleurs contenue dans les prémisses de la départementalisation, d’un Produit Intérieur Brut de pays développé et d’une structure productive de pays sous-développé.
Avant d’examiner les possibles évolutions, on s’attachera aux effets dans les consciences. Une illustration peut être donnée par les “affaires”, où il apparaît que les marchés donnent lieu à un partage des fonds publics entre politiques et entrepreneurs bénéficiaires d’appels d’offre truqués. Quand la pathologie excède la norme, c’est la norme qui est pathologique. La politique locale, inculpée par des juges “venus du froid” que cette incompréhension des usages fait encore plus lointains, plaide le procès politique et la justice coloniale. La récurrence des expressions qualifiant l’extranéité de la justice et des juges ne doit pas seulement être comprise comme une tentative de dédouaner le droit commun par le politique, elle exprime aussi, dans cette logique qui lie la capacité à dire le droit à l’appartenance territoriale - alors qu’un juge a pu déclarer : “Nous sommes sur la planète Code Pénal” - une appropriation et un retournement de la dépendance. Avec les pouvoirs conférés par la loi de Décentralisation, un personnel politique local affranchi de l’ère Debré met en place, comme l’a révélé l’affaire dite de la “billetterie unique”, une manière inédite de société d’économie mixte ou d’association en participation qui permet d’institutionnaliser la commission en courtage. Un opérateur habitué à travailler en Afrique et en Arabie Saoudite dira ne pas avoir été surpris d’apprendre qu’à la Réunion, la commission était de rigueur. En Arabie Saoudite, la commission est le droit d’entrer et le droit d’opérer que tout étranger doit acquitter à un répondant local, intermédiaire obligé pour être autorisé à faire affaire dans le pays. Elle neutralise, en quelque sorte, en intéressant un natif, le fait qu’un étranger prenne pied sur le sol national et tire profit de cette pénétration. Les affaires font apparaître la manière différente dont peuvent être impliqués les agents économiques issus des familles de “gros blancs” (ces “dinosaures”, selon le mot d’un protagoniste), qui soudoient les élus, avec “tous les moyens clandestins familiers à la jungle coloniale et semi-coloniale”, dirait Polanyi, pour obtenir une autorisation de construction d’un nouveau supermarché, les entrepreneurs d’origine métropolitaine qui disent devoir passer “sous les fourches caudines” des élus, et les entrepreneurs locaux sortis du rang, d’origine modeste souvent (“On est des paysans nés sur un tas d’oignons”) et n’appartenant pas à la communauté blanche, parvenus grâce aux concessions et aux marchés publics, illustrant à leur manière cette “promotion de l’homme réunionnais” chère au Président du Conseil Général et qu’il associe naturellement à sa “société d’économie mixte”. “Avant, tout était blanc”, note un courrier des lecteurs ; on fait une justice de classe et de race, clame un avocat. Quelle différence avec d’identiques “affaires” en métropole ? De même qu’on a pu parler de “culture de classe” à propos de la fraude électorale organisée par un parti de gauche dans les municipalités qu’il contrôlait, l’emploi communal permettant, là aussi, d’enrôler l’armée de réserve des partisans pour faire pièce au pouvoir - et quand il s’agit de se constituer un “trésor de guerre” qui permettra de livrer bataille à ceux qui ont l’argent naturel, la justification n’est pas différente - peut-on parler ici de culture de la dépendance. L’enrichissement personnel et le caractère systématique des prélèvements opérés sur les marchés publics n’étant que la signature post-coloniale de ces pratiques. Qu’est-ce que l’exercice du pouvoir, au fond, sinon le prélèvement légitime d’une part de la richesse collective à fin de représentation de la communauté - ce qui implique des frais de représentation personnelle reconnus - l’enrôlement d’ambitions individuelles dans un destin collectif ? Le caractère insupportable de cette justice venue du froid tient précisément à ce qu’elle s’interpose entre le souverain et son représentant naturel. Le “mal réunionnais” s’exprime ici dans ce divorce du légal et du territorial, expression d’une schizophrénie économique héritée de l’histoire.
C - Comores : communautés rurales et communautés urbaines.
Après avoir comparé les évolutions relatives de Mayotte et des trois îles composant la République Fédérale Islamique des Comores, le programme s’attachera à l’analyse des facteurs culturels qui conditionnent la réussite ou expliquent l’échec des projets de développement. Il s’agit d’étudier comment les structures déjà existantes dans les communautés villageoises ou urbaines peuvent être associées aux évolutions nécessaires, et comment, par exemple, telle valeur culturelle peut invalider un projet conçu sans connaissance approfondie des hommes et de leurs représentations.
Un part importante de la recherche sera consacrée à cette question cruciale qui engage l’avenir des pays en voie de développement : savoir comment, s’agissant ici des Comores, la tradition administrative comorienne, arrêtée dans son développement par l’histoire coloniale, peut retrouver son expression et sa vérité propre dans les formes modernes de l’Etat.
B. C.
Université de la Réunion
BIBLIOGRAPHIE
SOMMAIRE
Benoist, J. “De l’Inde à l’île Maurice et de Maurice à l’Inde ou la réincarnation d’une société.” Carbet, n° 9, décembre 1989.
Dumont, L. Homo hierarchicus : Le système des castes et ses implications. Paris, 1967.
Dumont, L. Homo aequalis : Genèse et épanouissement de l’idéologie économique. Paris, 1977.
Elloncle, G. Le chemin des villages : Formation des hommes et développement rural en Afrique. Paris, 1979.
Gauchet, M. Le religieux dans le politique. Paris, 1991.
Koenig, J.A. Inter-ethnicité et politique à l’île Maurice. Paris, 1991.
Mas, J. Les Indo-Mauriciens et le Code Napoléon. Mémoire pour le D.E.A. d’anthropologie de l’université de la Réunion. Saint-Denis, 1993.
Mauss, M. Sociologie et Anthropologie. Paris, 1950.
Narassiguin, P. Squarzoni, R. “La balance commerciale de la Réunion : Perspective historique et analyse régionale”. Annuaire des Pays de l’Océan Indien XI, 1986-1989.
Pisani, E. La main et l’outil : le développement du Tiers-Monde et l’Europe. Paris, 1984.
Polanyi, K. La Grande Transformation : Aux origines politiques et économiques de notre Temps. Paris, 1983.
Polanyi, K. Les systèmes économiques dans l’histoire et dans la théorie. Paris, 1975.
Rouland, N. Anthropologie juridique. Paris, 1988.
Simmel, G. Sociologie et Épistémologie. Paris, 1981.
Veblen, Th. “The Preconceptions of Economic Science”, in : The Place of Science in Modern Civilization. New York, 1919.
Verhelst, T. Des racines pour vivre, Sud-Nord : Identités culturelles et développement. Paris - Gemblout, 1987.
|
|